Littérature
Critiques littéraires
-
"La fille qu'on appelle" de Tanguy Viel (éditions de Minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Si la quatrième de couverture peut inciter à l’achat d’un ouvrage, elle se contente souvent d’évoquer le « fil conducteur » mais ne saurait rendre compte de ce qui est la force principale, la quintessence : le style. Que serait un « fil narratif » sans la spécificité d’une écriture si particulière à laquelle Tanguy Viel nous a habitué -légère dans sa complexité même, avec ses distorsions temporelles, ses ruptures syntaxiques, ses phrases longues et sinueuses, la rigueur de la construction, le souffle de l’émotion. Comme dans Article 353 du code pénal (2017) « l’intrigue » de « La fille qu’on appelle » prend la forme d’une déposition. Celle de Laura, qu’un « je » extérieur insère dans le récit d’une « descente infernale ». Le lecteur -à l’instar des deux policiers- est invité à écouter cette plainte.
« Dans les divers arts, et principalement dans l'art d'écrire, le meilleur chemin entre deux points même proches n'a jamais été, ne sera jamais et n'est pas la ligne droite » (Saramago) !
Dès l’incipit, la fusion des styles direct et indirect, le jeu des pronoms « elle » et « je » et l’emploi du conditionnel mêlé à l’imparfait ou au futur entraînent le lecteur dans un « avant » ; en fait il s’agit de la déposition faite par Laura, qui rappelle, face à deux policiers, son premier rendez-vous avec le maire (et puis donc elle a repris son récit). Déposition revisitée dès le chapitre suivant par un narrateur omniscient, (emploi du pronom « je »), qui fait entrer en scène Max le père de Laura et chauffeur du maire Quentin Le Bars. Max en père aimant sollicite un emploi pour sa fille (qui a quitté Rennes), Max boxeur attend fébrilement son « gala du 5 avril » (cette date-butoir, comme un mélange de prolepse et d’analepse (cf fin première partie « sauf que le 5 avril c’était demain »).
Coulissement du présent au futur dans le passé, énoncé de vérités aussi violentes que leurs sous-entendus (la force accusatrice ou disculpante du « paraître » par exemple), va-et-vient entre un « je » et un « elle » (qui le met à distance) rôle d’un narrateur censé commenter, contextualiser, dire, deviner ce que les personnages occultent plus ou moins délibérément, c’est ce qui prévaudra tout au long du roman. À cela s’ajoutent des procédés cinématographiques (grand angle, vues en plongée, montage alterné quand Max attend au volant de la voiture et que le maire…), des évocations de paysages d’ambiances et des références à la mythologie qui exhaussent le récit au rang de « tragédie ».
Les insinuations plus ou moins salaces des policiers, désarmés face à la franchise, la lucidité de la plaignante (dans la deuxième fois il y a les suivantes), leurs interprétations disculpant le maire en faisant valoir l’argument du « consentement », les privautés du maire -dès le premier entretien- jusqu’à…, en passant par la phase anticipatrice de l’innocence (séduit malgré lui par une salope), la collusion entre les « pouvoirs » incarnés par ces VIP qui se côtoient au Neptune (casino géré par Franck Bellec), une succursale de la mairie surnommée « ministère des finances », tout un agencement arachnéen de faits qui vont précipiter le père et la fille dans une « souricière » aux odeurs de soufre (ce qu’avait pressenti dès le début Franck Bellec en comparant Laura à un baril de poudre et Max le père à l’allumette qui ne demandait qu’à être craquée »).
Composé de deux parties ce roman enchâsse donc plusieurs niveaux d’écriture et de « récits » ; celui d’une déposition (que scandent les expressions a-t-elle dit, elle a dit, je peux vous dire) mais où Lauradonne l’impression d’être comme extérieure ; le récit-analyse de cette déposition -tel un making of- avec ses arrière-plans (évoqués sous forme de flashback) où l’environnement -et particulièrement la mer-, joue le rôle de personnage (prolongement ou métaphore des sentiments éprouvés par le(s) personnage(s)) où la suggestion prime sur la description en faisant de la « géographie » de la ville une « géographie » intérieure.
La première se clôt sur les révélations d’Hélène -la sœur de Frank- révélations qui sur Max font l’effet d’un uppercut. La seconde s’ouvre sur la défaite de ce même Max, terrassé sur le ring par son adversaire Costa, ce 5 avril. « Version compressée de son existence » et cette affiche qui le nargue !!! Absenté du monde. Puis tout semble se précipiter : dépôt de plainte -la longue pelote de récit, une histoire d’emprise, celle que précisément nous avons lue, entendue en I; la contrattaque de Le Bras et Bellec (des photos de Laura posant nue), la pusillanimité de l’avocat de Laura, la venue de Le Bars ministre, l’évasion de Max et son « geste »… L’affiche (symbole de la « renaissance » de Max) a subi les outrages de la pluie et du vent et pourtant suaire périmé elle continue à porter dans ses déchirures le portrait intime du véritable Max celui dont le cerveau tel un cerf-volant « vous soulève et suspend la tête en l’air dans les cieux.
Et la séquence finale qui emprunte autant au théâtre qu’au cinéma (délimitation de l’espace, rôle muet de certains acteurs, échange de regards, estrade devenue ring, Max/ Spartacus et les mâts des bateaux comme arbitres, Max /Neptune armé de ses gants /trident) est un modèle d’écriture, de suspense, d’ironie aussi dans la « célébration » de la vengeance.
Dans un monde normal on n’aurait jamais dû se rencontrer ! affirme Laura tout au début du roman… mais qu’est-ce que vous appelez un monde normal ? ils ont demandé. Je ne sais pas… Un monde où chacun reste à sa place. Un mondeoù Frank obéit au maire et le maire obéit à son désir ; un monde « à la vassalité tordue », un monde oùla « parole » des nantis, des édiles ou des « politiques » a le primat -par le jeu d’euphémismes, de circonlocutions, de dénégations – sur celui des « administrés » (il faut entendre cet élu local, devenu ministre, ce Quentin Le Bars, clamer son respect et son amitié pour celle qu’il a pris plaisir à abuser !! ), un monde où la parole des gardes du corps « ta gueule » fait office de sésame, -la trivialité ailleurs fustigée est ici tolérée-, un monde où le langage des « oubliés » des « invisibles » est bafoué (à l’instar de leurs locuteurs). Or « celle qu’on appelle » en « osant » prendre la parole contre le « patriarcat », n’a-t-elle pas dérogé à cet « ordre » ?
Un père et sa fille, Max et Laura, tous deux victimes du cynisme ambiant : père « coupable », fille « affabulatrice » mais le « dépositaire de l’autorité publique » sortira « grandi » !
Ainsi va le « monde normal » -quibroie les humbles et affranchit les puissants, ordures comprises (Jérôme Garcin)
-
"Une sortie honorable" d’Éric Vuillard (éditions Actes Sud)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
C’est à un nouveau défi que nous convie Eric Vuillard dans « Une sortie honorable ». Pour « raconter » la guerre d’Indochine et plus particulièrement la défaite de Diên Biên Phu, en 1954, qui met fin à la présence coloniale française, le voici qui furète dans l’ombre, investit les « coulisses », met en scène jusqu’à la farce caricaturale parfois, des personnages politiques, des banquiers connus (ou non) du public, interroge le langage et ses mesquines hypocrisies, en stigmatisant les crimes des « dominants ». Le titre, modèle d’antiphrase, il l’emprunte au président du Conseil René Mayer, de même que la photo qui figure sur la page de couverture -le couple de la Croix de Castries apparemment heureux- prise en 1954 serait un modèle d’illusion ! Et comme dans ses précédents récits, l’auteur met en résonance passé et présent, ce dont témoignerait aisément une construction « circulaire » ou du moins une forme de « continuum » métaphorisé par les « fils » (de fer ou d’or). Un récit vif, alerte servi par une écriture inventive et facétieuse.
Composé de 22 chapitres, il suit un ordre chronologique -de la défaite de Cao Bang contre le Viêt Minh, à celle de Diên Biên Phu- avec une séquence d’ouverture située en 1928 qui joue le rôle de prologue et la défaite de Saïgon en 1975 celui d’épilogue, en passant par les discussions houleuses à l’Assemblée, et sa galerie savoureuse de portraits, les descriptions précises des lieux stratégiques, les préparatifs et les conséquences, et des considérations sur un système d’exploitation forcené de l’homme par l’homme !
Et pour chacune de ces scènes/séquences (consacrées à un personnage ou à un épisode de l’histoire) le rythme de la phrase, la profusion de détails, le jeu de flash-back (car par souci pédagogique il faut remonter dans le temps) ou de prolepses (comme procédés d’attente), l’alternance entre présent dit de narration et passé simple, les anaphores qui scandent un paragraphe, les exhortations au lecteur et l’ingérence-immixtion du « narrateur » (emploi du présent de vérité générale, emploi du pronom « je » ou de l’adjectif possessif « nos ») contribuent non seulement à rendre le récit très vivant, mais à solliciter une « participation » active du lecteur en lui proposant un autre regard sur des faits avérés, en les contextualisant et les inscrivant dans une Histoire plus large.
En tant que forces dynamiques, continuum et enchevêtrement assurent une forme de tempo ; bien que de nature différente -idéologique et narrative-, les deux s’entrelacent ou sont concomitantes. Si le roman s’ouvre sur des extraits d’un guide de voyage sur l’Indochine de 1923, n’est-ce pas pour dénoncer l’hypocrisie du langage ? Laquelle prévaudra dans la séquence suivante de ce même chapitre (1928 des inspecteurs mandatés par la France découvrent les horribles conditions de travail des « employés » dans la plantation Michelin ; leur rapport restera lettre morte) et dans nombre de chapitres suivants (circonlocutions dans les discours des députés à l’Assemblée en 1950, correspondances officielles, interview télévisée ou procès). Quelle que soit l’époque, quel que soit le locuteur, (hormis Mendès-France, modèle de lucidité, et François Mauriac) c’est le même cynisme éhonté, la même dénégation, la même dissimulation. À cela s’ajoutent les pouvoirs quasi démoniaques des banques (dont celle d’Indochine à une époque) leur mainmise sur l’ensemble des activités économiques par l’intermédiaire de filiales -bois, or, cuivre, ciment, « nous voyons bien que nous marchons sans cesse dans les mêmes traces, que nous nouons toujours les mêmes fils autour des mêmes pantins, et ce ne sont pas des fils de fer attachant des poignets faméliques, ce sont des fils d’or liant et reliant les mêmes noms, les mêmes intérêts… On croiserait les mêmes cent fois comme on croisait jadis le même hévéa transplanté des milliers de fois dans la plantation de Phu-riêng ». La reprise des mêmes expressions, la répétition de l’épithète même s’inscrit à la fois dans une construction « circulaire » (narration) et une diatribe contre la toute-puissance maléfique de la finance (qui sévit encore de nos jours) sur fond de « refoulé colonial » (c’est entre autres contre cette vision de l’histoire qui oppose dominés et dominants, que s’est insurgé J.C. Buisson, dans le Figaro, accusant É. Vuillard d’être l’adepte d’une littérature postmarxiste chic et choc et de biaiser l’histoire dans un livre ennuyeux. Ne cédons pas à la polémique facile, n’intentons pas un faux procès ; rappelons simplement l’objectif poursuivi par Éric Vuillard de récit en récit, réinventer un discours littéraire possible à partir du fait historique.
Que pouvait signifier l’expression « une sortie honorable » au moment de la guerre d’Indochine ? sinon qu’il fallait relancer la guerre pour en finir et reconquérir une partie de l’Indochine avant de la quitter ? (Chapitre 9 « une sortie honorable »). N’est-ce pas au final le dispositif essentiel d’une entreprise coloniale ?
Et voici que résonne l’explicit tel un uppercut émotionnel et politique
« Dans l’espérance d’une « sortie honorable » il aura fallu trente ans et des millions de morts… trente ans pour une telle sortie de scène. Le déshonneur eût peut-être mieux valu. »
-
"Poussière dans le vent" de Leonardo Padura (Editions Métailié)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis
Dans ce roman à la chronologie éclatée, au jeu incessant d’allers-retours, Leonordo Padura avec ce sens du récit -qui peut rappeler le roman policier- sa science du montage qui nous fait passer avec fluidité d’une temporalité à l’autre, sa maîtrise des analepses et prolepses, explore une thématique qui le taraude : l’exil. Comment a-t-on pu en arriver là ? Où va-t-on ? Questions lancinantes que se posent les protagonistes de « Poussière dans le vent ». Une génération, celle de l’auteur, prise entre fidélité et trahison, sentiment d’appartenance et déracinement, ce déchirement de se séparer d’une partie de soi, génération confrontée au dilemme : rester ou partir ?Leonardo Padura, lui, a fait le choix de rester à La Havane – même s’il a deux citoyennetés (cubaine et espagnole) il revendique « une seule nation » !!! Clara, le personnage principal du roman, n’est-elle pas son double ? elle qui porte à jamais « sur son dos sa maison culturelle » comme l’escargot sa coquille…
Le titre du roman est emprunté à la chanson « dust in the wind » dont un extrait est cité en exergue. Et un autre jouera le rôle d’épigraphe (dernier chapitre « la victoire finale »). Dès le chapitre II lors de l’anniversaire de Clara (on fête ses 30 ans au Fontanar) Bernardo le mathématicien, mari d’Elisa, a tenu à faire écouter la voix de Steve Walsh (groupe Kansas) et entendre le violon de Robby Steinhardt. (étrange mariage « de la fête et de la mélancolie » songeait Clara !!). Nous sommes en 1990 c’est à ce moment que Walter prend une photo du « clan ». Photo que Marcos (il est alors à Hialeah Miami) a montrée (chapitre I) grâce à Facebook à sa compagne Adela Fitzberg qui, intriguée, est persuadée d’identifier sa mère enceinte (en la personne d’Elisa). Adela, fille de Loreta -elle « aurait déserté » Cuba- et d’un père argentin (du moins est-ce sa conviction), lui Marcos fils de Dario (définitivement exilé en Catalogne) et de Clara (une des rares du « clan » à ne pas avoir « déserté » l’île).Et ce n’est pas pur hasard si le roman s’ouvre précisément sur cet épisode : la photo comme déclencheur… de l’enquête que mènera Adela (Chapitre IV La fille de personne), enquête sur ses origines, sur la génération qui a connu la Révolution, une enquête qui est aussi quête de soi ; une photo prise en 1990 date fatale pour l’avenir du peuple cubain -qui connaîtra pénurie et misère- ; 1990 date dans le roman du suicide de Walter et de la fuite d’Elisa (ces deux drames sont-ils liés ?). Et ce n’est pas non plus pur hasard si le roman se clôt sur le « devenir » des mêmes personnages Adela et Marcos, alors que les « différentes énigmes » ont été résolues et les « secrets » mis à jour… -soit après presque 30 ans d’incertitudes ! Le thème du double Elisa/Loreta, pris dans l’acception de « duplicité » est à mettre en parallèle avec le livre d’Orwell 1984 que les protagonistes avaient lu dès 1981… support à une réflexion critique sur le régime castriste, réflexion qui ébranlera leur foi en l’avenir promis par Fidel Castro, et prémices des « départs » -définitifs, pour certains…
L’enchevêtrement dans le temps et les constants allers et retours entre le passé (début années 1960) et le présent (2016) le télescopage de plusieurs périodes et la reprise -telle une variation- de faits identiques (la photo prise en 1990, le briquet de Walter, le baiser Clara/Elisa, le roman d’Orwell, la sculpture l’Ange déchu inspirée du Laocoon et ses fils entre autres) ne sont pas seulement au service de structures narratives élaborées ni du « suspense » (que le romancier se plaît à entretenir) mais aussi l’illustration de cette foi en la mémoire « se souvenir sera toujours mieux qu’oublier même si c’est un processus douloureux ». À la chronologie éclatée correspond (ou répond) un éclatement géographique (Cuba, Miami, Barcelone, Madrid, Toulouse, Porto Rico, Buenos Aires) qu’incarnent précisément la plupart des protagonistes (les huit du Clan, auquel se sont ajoutés les amis et les enfants) ; éclatement comme métonymie de la diaspora cubaine ?
Poussière dans le ventse lit, s’écoute comme une polyphonie (certains y verront un roman choral, alors que le récit- hormis les monologues ou les lettres- se fait à la troisième personne…) avec ses solos, ses tutti, ses contrepoints, ses leitmotive. Leonardo Padura prend en charge le destin de chacun, et ce faisant il l’inscrit à chaque fois dans un contexte précis (historique social et économique). En traversant différentes époques et différents pays, nous sommes à même de « vivre » un quotidien « vérifiable » (on vilipende le castrisme ? mais ailleurs dans les sociétés dites démocratiques n’est-ce pas le triomphe des effets pervers du libéralisme…) L’auteur ne juge pas ses personnages, tout comme Clara qui, à 36 ans, dans un long monologue intérieur, s’interroge sur le bienfondé de tel ou tel choix et semble les « comprendre » tous… mais « elle ne savait pas encore que la vie lui réserverait de nouvelles séparations plus douloureuses encore ». Dissidence et diaspora !
Sensualité et érotisme, éducation et transmission, politique et histoire, autant de forces vives que le romancier traque, débusque par-delà l’apparente fragmentation – en harmonie d’ailleurs avec la diversité des parcours. Poussière dans le vent : une immense fresque -non sans quelques « rondeurs »- à la fois réaliste et mélancolique, colorée et odorante, truffée de références littéraires et picturales !! Gardons en mémoire les propos d’Adela sur les « émigrés » (chapitre I) « pour avoir vécu parmi des émigrés Adela savait que personne ne quitte l’endroit où il est heureux à moins d’y être forcé -et c’est alors en général qu’il perd le fragile état de bonheur » ou la douleur existentielle d’Irving exilé à Madrid (la conviction de ne plus avoir d’appartenance ne le quittait jamais -chapitre III)
-
"La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr (éditions Philippe Rey Jimsaan)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Mohamed Mbougar Sarr dit s’être inspiré de l’œuvre et du destin de Yambo Ouologuem, mais son roman La plus secrète mémoire des hommes qui vient d’être couronné par le prix Goncourt, n’est en aucun cas une exofiction, et ce, malgré quelques évidentes similitudes -deux jeunes auteurs sénégalais Yambo Ouologuem et T.C Elimane, une œuvre unique Le devoir de violence et Le labyrinthe de l’inhumain, une œuvre vouée aux gémonies et un questionnement pourquoi se sont-ils tus ? Tout au plus l’écrivain malien (1940-2017) sera une silhouette tutélaire. C’est Roberto Bolaño (1953-2003) auteur des Détectives sauvages, et cité en exergue, qui sera le « guide » ; il lui emprunte d’ailleurs le titre de son roman « Un jour l’œuvre meurt, comme meurent toutes les choses, comme le Soleil s’éteindra, et la Terre, et le Système solaire et la Galaxie et la plus secrète mémoire des hommes ».
Diégane Latyr Fay, le narrateur, jeune écrivain sénégalais, après avoir découvert, intrigué, Le labyrinthe de l’humain, va mener une enquête sur son auteur T.C. Elimane, surnommé en son temps, 1938, « le Rimbaud nègre ». Une enquête tel le « froissement de fourrés dans une jungle drue » mais qui est aussi quête de soi. D’où ces deux forces qui animent le roman : questionnement sur l’acte d’écrire, sur la littérature (son essence, sa finalité) et sur soi aux prises avec des contingences érigées parfois en nécessités. Le credo ? ne pas écrire si tu n’as pas l’ambition de faire trembler l’âme d’une personne. Un roman au sujet ambitieux où s’enchâssent de nombreux récits, où se mêlent différents genres littéraires, où une sensualité effrénée peut côtoyer l’autodérision, où le trivial épouse l’érudition, un roman irradié de jeux de miroirs et de mises en abyme, Elimane ou l’allégorie de la littérature ?
Le roman s’ouvre sur un semblant de « résolution » ; épuisé par les récits de l’Araignée-mère (Siga D) le narrateur décide en ce 27 août 2018 de suspendre son journal ; de « fermer sa gueule ». Par le subterfuge d’une chronologie inversée le lecteur se familiarise d’emblée avec le « cercle littéraire » de Diégane, déguste ses appétences, se moque de ses prétentions littéraires (vocabulaire érudit formules amphigouriques) et de ses gaucheries d’amant, s’interroge sur ces nombreux aphorismes au pédantisme teinté d’ironie ! il entre de plain-pied dans les coulisses de la Création littéraire et surtout il est complice d’une fascination : T.C. Elimane a séduit et intrigué par « la facilité de son adieu au soleil, l’assomption de son ombre ». On ne rencontre pas Elimane il vous apparait il vous traverse il vous glace les os et vous brûle la peau c’est une illusion vivante.
Nous voici sur les traces de…T.C Elimane.
À l’instar d’une symphonie, le livre premier joue le rôle d’ouverture ; et le roman obéira à des effets de circularité concentrique : retour des mêmes personnages (dont Siga) avec enchâssement de récits au service d’une évocation toute en entrelacs avec ses glissements ses superpositions ses fondus enchaînés. Une enquête à la complexité dédaléenne -le labyrinthe servant de motif qui relie espace et temps. Ainsi le long récit de Siga (à Paris et Amsterdam) ramène au passé (Siga reproduit le récit de son père Ousseynou Koumakh le mage aveugle) ; car un personnage en appelle un autre, (Brigitte Bollème la journaliste, Thérèse Jacob, Claire Ledig (des éditions Gémi), ou encore la poétesse haïtienne) et le lecteur devenu auditeur peut manifester la même impatience que Diégane. Un même récit peut être repris mais sous une autre forme et avec plus amples informations (celui de Ta Dib la troisième femme d’Ousseynou Koumakh rencontrée au Sénégal) dans ce jeu de pistes qui se confond parfois avec un roman des origines et cet effet de mise en abyme où chaque personnage est un enquêteur sur les traces de… Elimane, lui-même, Ange et Démon, n’était-il pas, lors de son séjour en Argentine, à la recherche de… ?
Multiplicité des points de vue, multiplicité des genres littéraires: le roman de Mohamed Mbougar Sarr mêle avec habileté le journal, la confession, le fantastique, le suspense, le roman d’initiation, des extraits de presse, de correspondance (en italique) échanges de SMS (entre Diégane et Aïda), lettres envoyées par Elimane à son oncle et à sa mère avec insertion d’une lettre de son « père » Assane, long courriel de Musimbwa ou encore au final cette lettre-testament d’Elimane). Multiplicité des approches aussi - littéraire, politique, historique, sociale, voire philosophique - d’un personnage peut-être insaisissable !!! Vertigineuse énergie narrative !
Mais le lecteur était prévenu dès l’incipit: l’œuvre littéraire tout comme les étoiles est vouée à disparaître « D’un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci : l’un et l’autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu’on puisse imaginer, une longue route circulaire, où leur destination se confond avec leur origine: la solitude. Nous avons suivi Diégane de Paris à Amsterdam, de Buenos Aires à Dakar, à la recherche d’un écrivain disparu dont « Une seule de ses pages suffisait à nous donner la certitude que nous lisions un écrivain, un hapax, un de ces astres qui n’apparaissaient qu’une fois dans le ciel d’une littérature » Nous avons interrogé cette voie lactée où brillent ces étoiles filantes, amies d’Elimane (Ernesto et Gombrowicz en Argentine, Mossane la mère qui dans sa folie a réuni forces chthoniennes et apolliniennes) et toutes ces figures tutélaires de Diégane (dont Aïda la journaliste des révoltes populaires et l’amante Je sentais les lents spasmes de son sexe autour de ma verge, et la crue grossissant en elle, et l’étoile blanche en elle qui allait bientôt exploser et éclabousser l’univers jusqu’en ses confins inconnus).
Le fantôme de Madag (Elimane) viendra-t-il murmurer « les termes de la terrible alternative existentielle qui fut le dilemme de sa vie : écrire, ne pas écrire ?
Mais il se peut qu’il n’y ait rien à trouver dans la littérature
Est-ce ce rien « la plus secrète mémoire des hommes »
INDÉCENTE LITTÉRATURE COMME RÉPONSE COMME PROBLÈME COMME FOI COMME HONTE COMME ORGUEIL COMME VIE
-
"Une certaine raison de vivre" de Philippe Torreton (éditions Robert Laffont)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
« L'homme qui plantait des arbres », un viatique ? Dès sa lecture "épiphanique", Philippe Torreton a pris cette nouvelle écrite par Giono, sur lui comme on met un couteau dans sa poche.
Jean Fournier le "héros" du roman "Une certaine raison de vivre" s'en vient recueillir en 1947 les rares objets de feu Elzeard Bouffier, le berger christique, l’homme qui plantait des arbres. Et parmi les objets reliquaire/viatique, un couteau (1947 chapitre 1).
Dans la postface, l’auteur affirme que tout est parti de là « une quête de je ». Qui est le je qui raconte la nouvelle de Giono ? Un narrateur omniscient ? l'auteur provençal ? auquel un autre « je » va rendre hommage, en faisant "vivre" un personnage de fiction Jean Fournier, "rescapé" de la première guerre mondiale… mais "broyé de l'intérieur" et qui apprendra du berger une « certaine raison de vivre ». Seul témoin direct d’un homme exceptionnel, Jean poète et auteur dramatique, va rédiger ce texte/épitaphe gravé dans son élan oblatif, syllabaire pour la mémoire de tous.
Croiser son alter ego -par tout un jeu de miroirs, d’effets spéculaires. Un « je » dont il faut se déprendre et habiter en tant que sujet ? là serait l’enjeu de la création… ? Ecoutons ce « je » multiple dans son unicité même, écoutons ces voix qui, par-delà la fiction, résonnent d’un vibrant hommage à l’homme qui plantait des arbres, écoutons ce concert des vibrations séculaires les "confuses paroles" des "vivants piliers" de la Nature, que sont les arbres.
Le roman se déploie en plusieurs parties de longueur inégale et à la chronologie délibérément éclatée (dont rendent compte les titres réduits à une date, moments forts d’un parcours), tout en obéissant à une construction circulaire. Il s'ouvre sur le voyage entrepris par Jean Fournier convoqué à l’hospice de Banon afin de récupérer les "affaires" de feu Elzeard Bouffier ; et ce qui est annoncé dans ce chapitre liminaire (1947) - la première rencontre en 1913 avec le berger, les traumas de la guerre, Alice et Rachel, le théâtre -, sera repris explicité amplifié - à l’instar de variations ou de leitmotive. En écho, le dernier chapitre 1947 à valeur conclusive -tel un dénouement- réconcilie par-delà la mort, toutes les forces vives que nous avions côtoyées. « Forces » qui avaient pu se contrarier : ainsi la « fugue » de Jean (1922) -il a rejoint le berger sans prévenir les siens-, provoque la « maladie » de sa femme Alice et l’annulation du mariage ! Alice perspicace sait (1925 chap 8) que le « berger était la cause de son plus grand malheur ».
Pour le lecteur c’est le démêlement progressif d’un lacis (Jean et ses visions cauchemardesques qui contaminent son présent, et simultanément Jean et ses visions enchanteresses des hauteurs boisées qui contaminent le style par des jeux de métaphores) ; démêlement d’un enchevêtrement de plusieurs écritures (dont celle en italique des textes écrits par Jean, avec ses idiotismes, sa syntaxe écorchée, son lexique dialectal et qu’apprécie l’acteur Bastien « on y parle comme dans la vie, il n’y a pas une langue mais des langues. Sur les scènes parisiennes on n’en parle qu’une, la même. Tout ce qui est patois, les accents ne servent qu’à ridiculiser un personnage » (1937 chap 12) L’écriture comme force exorcisante ? Oui mais… « à force de côtoyer Elzeard il (Jean) avait compris aussi que les mots devaient être l’ultime recours, une dernière option avant l’incompréhension : le silence, les yeux, le corps ne sont pas muets, aussi avait-il repris ses textes et biffé comme un beau diable tout ce qui lui semblait superflu » (1942 chap 23)
Jean Fournier le jeune homme gracile qui préférait regarder et se taire à la frange du monde, avait été projeté dans la guerre à 21 ans… Un miracle après cinq années d’infanterie « deux bras et deux jambes valides une tête avenante épargnée par l’obus et la baïonnette » ! Et pourtant ! Une démobilisation (1920 chap 4) vécue sur un mode cauchemardesque « ça gueulait, ça essayait de carotter, ça s’empoignait sous les yeux des pandores débordés » Jean a 27 ans ; lui l’amoureux de Virgile et de la poésie ! lui dont le regard juvénile suinte l’enfance ! Derrière son masque de joli garçon une guerre continuait, une guerre sans armistice sans clairon final. Et il écrit pour ses morts dont une suite accumulative d’adjectifs au réalisme cru rend compte (1925 chap 8). De même par un procédé de fondu enchaîné des images du passé peuvent se substituer au présent (images de soldats pétrifiés, un fumoir béance de tranchée). La guerre est devenue cette allégorie qui bringuebale sa carriole dans les crânes à tourmenter ; la guerre qui vient emmerder Jean dans la boutique du tapissier (il voit un soldat mort dégoulinant de chair béante et de sang terreux à la place des rouleaux de tissu), dans l’urinoir du Théâtre des Champs-Elysées (soldat gelé dans un linceul blanc (1921 chap 14) ou encore à l’hôpital où le « chef de service expectore l’ypérite et lui-même remugle le dichlore (1922 chap 17). Car pour lui l’avenir s’est fracassé à Verdun ; le futur est une langue morte. « Je pense que je suis la seule veuve de guerre dont le mari vivant est devant mes yeux » avouera Alice.
Persuadé que le berger allait remettre son cerveau dans le bon sens, que voir le monde avec des yeux sans guerre dedans et des souliers qui ne s’étaient jamais enfoncés dans des poitrails humains décomposés ne pouvait être que salutaire, Jean continue à s’entretenir avec lui par la pensée, quand il ne lui rend pas visite ; un tableau de Lucien Penat « le Bourbonnais » chez son beau-père ressemble étrangement à Elzeard Bouffier qui le regarde… En un long paragraphe (1942 chap 24) au style indirect Jean va « raconter » (il évoqua) à son beau-père la genèse d’une rencontre et ces « milliers de chênes » cette forêt tutélaire alma mater, l’exact contraire de Verdun. Est-il possible, envisageable deconstruire son existence entre ces deux forces antipodales ?
Bastien est seul sur scène pour une ultime représentation « on ne sait rien des arbres on sait tout de la guerre ; ils nous survivent pourtant, ils enfilent les siècles en petits cerceaux. Dans leur bois il y a notre écho ».
Et les mots s’en viennent percuter les pensées de leur auteur, Jean. Ovations FIN
En 1947, à 54 ans Jean est à même de « semer » la Vie.
Il a rangé les linceuls, effeuillé la douceur de la nuit, le vacarme des atrocités s’est tu…
« Fais de chaque seconde une expérience enrichissante. Le présent est la seule chose qui n’ait pas de fin » (proverbe amérindien)
-
"Rien ne t’appartient" de Nathacha Appanah (éditions Gallimard)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix des librairies de Nancy 43ème édition du Livre sur la Place (septembre 2021)
Dans ce roman où le frémissement d’un passé ressuscité s’en vient contaminer le présent, où la suggestion et les ellipses atténuent sans l’édulcorer la force explosive des arrachements et/ou des horreurs, la romancière donne la parole à une jeune femme qu’on a dépossédée de tout. Délicate et sensuelle, l’écriture de Nathacha Appanah s’insinue dans les méandres d’une pensée désaccordée et dans les fibres d’un corps mutilé par des affres indélébiles. Un roman de l’enfouissement dont le tsunami de 2004 serait à la fois matérialisation et métaphore. Un roman bouleversant sur la perte irrémédiable de l’enfance, la double identité, la reconstruction -ou le deuil-, dont la tonalité est d’emblée suggérée par l’exergue emprunté à Jamaica Kincaid Au fond de la rivière.
Composé de deux parties « Tara » et « Vijaya » - deux prénoms, deux fils narratifs, deux temporalités mais en ordre inversé ?- le roman obéit à une architecture secrète voire musicale où « le même » et le double, la vie « réelle » et la vie « fabriquée », les récurrences -voire l’omniprésence- de l’eau, les « échos intérieurs » créent une symphonie, -les « thèmes » annoncés en I seront repris en « variations », amplifiés, auréolésd’une musique sombre funèbre ou mythique.
Au début (hic et nunc) nous pénétrons dans un appartement dévasté. Tout est en vrac. À l’instar de la narratrice d’ailleurs, qui depuis la mort de son mari Emmanuel ne peut lutter contre les « fantômes » qui l’agitent. Emmanuel était un « rempart » contre un passé qu’elle croyait à jamais enfoui. L’écriture va épouser les hoquets de la pensée et les brillances intermittentes des visions jusqu’à se décomposer Si. Je. Me. Tiens. Tranquille… Qui est ce garçon qui a traversé le temps les époques les mémoires,s’assieddans le fauteuil et la fait chavirer ? Cette jeune fille dont la présence torturante pousse en elle contre ses flancs ? Que signifient ces trous de mémoire ? Les repères temporels se brouillent alors que le temps mécanique du hic et nunc est à la fois étréci et dilaté 18h07, 19h32, 4h du matin et le rendez-vous de 11h chez le neurologue- Eli (le fils d’Emmanuel) est désemparé. Et pourtant ces fugitives impressions : tableaux, odeurs, lumières qui s’imposent par flashs sont comme les prémices d’une recomposition/reconstruction à l’image de la danse des syllabes « tât taï taam dîth taï taam ». Moins déjouer un écheveau temporel que ressusciter un autre moi une autre fille avec un autre prénom, voir « un corps s’extirper de moi aller au-devant sans peur sans âge courir se tenir en équilibre au-dessus de moi-même »« l’écouter raconter son histoire». La parole dérobée ou confisquée, Nathacha Appanah la ressuscite dans la seconde partie Vijaya. Ce qui « était en vrac » (I) se « recompose ». Depuis l’enfance édénique jusqu’à la rencontre à 20 ans avec Emmanuel -son « sauveur », en passant par les épisodes violents douloureux où la jeune Vijaya est « le chien méchant » puis la « fille gâchée » victime d’opprobres, malversations et humiliations, chacune des « étapes » est restituée dans sa coloration particulière, sa tonalité, un style qui en préserve la spécificité. On retiendra les chapitres consacrés à la découverte des plaisirs de la chair, à la rencontre épiphanique de l’amour ; Impudeur innocente, voluptueux abandon de tous les sens ! où la nudité glorieuse est le seul atour. Ou encore celui évoquant le tsunami annoncé par un constat à la disposition typographique particulière. Si le personnage s’exprime toujours à la première personne, si le récit suit l’ordre chronologique, le recul invite parfois à une distance critique (cf le chapitre 6 scandé par l’anaphore « personne ne m’a jamais dit » ou le chapitre 11 -prolepse ou analepse ? quand Tara, pour préserver Emmanuel, a choisi d’occulter la « vérité » et de « fabriquer » un leurre).
Le constat « l’eau/ toute cette eau » dont la disposition typographique épouse l’enroulement fatal dans l’immersion, était comme la « coda » de la première partie, au moment où Tara se laisse entraîner par son chagrin vers le fond. Phrase suspensive et conclusive se confondent. Le tsunami ce chagrin qui emporte tout dans sa puissance dévastatrice ! L’eau le leitmotiv de tout le roman ! Dès le début, l’énoncé « seule l’eau est vive, elle enfle elle bouillonne elle remonte du centre même de la terre, devenue source jaillissante » préfigure toutes les figures de style (« les pensées prennent l’eau » être submergé par la « vague de la mémoire » « le lit d’amour devenu radeau et le sol la mer sans fond »). C’est aussi l’illustration d’une démarche qui va de l’engloutissement à la captation, de l’immersion à la résurgence. L’enfance et sa fin brutale, l’amour et les interdits, la dépossession (rien ne t’appartient ici : des mots qui englobent ma peau mon corps mes pensées ma sueur mon passé mon avenir, mes rêves et mon nom) tant d’épreuves dont l’image de l’enfermement (dans le coffre de la voiture, dans la case, dans les rites et croyances imposé.e.s) accentue le tragique. Tant d’épreuves où se lit -mais en filigrane- la critique de la romancière. En filigrane car Nathacha Appanah ne désigne pas nommément les lieux (on imagine aisément le Sri Lanka), se contente d’allusions aux « guerres » ; la « dénonciation » -paradoxalement- n’en sera que plus percutante (tout ce qui est beau nous est arraché). À l’inverse, elle célèbre la « sororité » : Avril Tara et les autres, ces réprouvées de la société, ces sœurs du malheur, installées au Refuge sous la férule d’Amma, « comprennent mieux que quiconque l’inutilité des paroles quand remontent le manque et le chagrin » et quand Avril est « condamnée », son [mon] cœur heureux bat de quelque chose de plus grand que moi éprouvant cette sororité jusqu’au bout de mes doigts.
C’est sur la guirlande de manguier que se clôt le roman. Eli la dédie telle une épitaphe à sa belle-mère -tout comme le roman d’ailleurs s’inscrit dans cet élan oblatif. « Les feuilles vertes à la sève odorante éloignent le chagrin » -affirmait Tara-, quand bien même c’était pour « satisfaire le goût des « gens d’ici » pour « ce genre de folklore exotique » (I)
Une guirlande d’où se détache un « visage, une expression à la fois douce et inquiète » le sien
« tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change »
-
"Les filles de Monroe" d’Antoine Volodine (Editions Seuil)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Une image fixe, grise, aura remplacé le monde. Plus rien ne bouge (Danse avec Nathan de Lutz Bassmann)
Arrêt sur image, temps momentanément suspendu, ainsi s’ouvre le roman « Les filles de Monroe ». Un roman composé de 7 chapitres répartis en 49 fragments qui se clôt sur la liste des 343 fractions du Parti au temps de sa gloire (on sait l’importance du chiffre 7 et de ses multiples sur l’échiquier de Volodine…). Un roman où domine le noir, empuanti d’odeurs méphitiques, où la pluie crépite, bourdonne ou ruisselle à chaque page, où morts, vivants, malades, rescapés, semblent interchangeables, enfermés dans des pavillons spécialisés, un monde post-exotique auquel Volodine et ses hétéronymes ont habitué le lecteur. Un roman où les « filles de Monroe » -ces femmes guerrières -sœurs de Kree ?- telle une brigade volante, vont « revenir », sur « terre »- dans l’immense cité psychiatrique. Acrobates du temps et de l’espace, contorsionnistes du langage, pourront-elles accomplir leur mission « rétablir la logique du Parti, dans cette dernière longue marche de l’Histoire » mission dont le dissident Monroe les a investies ? ou cette prétendue mission n’est-elle que la perspective d’un prochain livre dont la fin échappe à ses protagonistes ?
La scène inaugurale frappe par sa théâtralisation et ses effets cinégéniques ; elle sera répétée deux fois ; un travelling ascendant ou descendant avec arrêt sur image ; plan pénétrant mais comme démultiplié par des jeux de miroirs, car il y a l’œil du regardeur, celui de la lunette, la chambre avec vue comme observatoire, dans une ambiance de film expressionniste. Réel -ou prétendu tel- et rêves des morts apprivoisés ! Le narrateur et Breton (l’ambigüité de l’énonciation qui joue avec les instances narratives « je » et « il » laisserait à penser qu’il s’agit de la même personne ou du moins d’un double) sont non seulement chargés de repérer les personnes subversives,- ces filles qui « ayant quitté l’espace noir » pénètrent dans la cité par la rue Dellwo, s’introduisent dans le cauchemar des vivants- et d’en avertir les supérieurs ! Mais ils sont aussi les seuls à « voir les songes des morts » (grâce à leur pratique du chamanisme) au grand dam des médecins policiers et cadres du Parti. Installés dans la maison des cosmonautes ils bénéficient du matériel optique (pour leurs nuits de guet) disposent d’un échiquier (tout un symbole et/ou mise en abyme ??) subissent régulièrement pressions et tortures. Mais dès le chapitre III, on sait qu’ils vont apporter leur soutien aux « filles de Monroe », dont Rebecca Rausch -que le narrateur avait follement aimée trente ans plus tôt…
Pavillon des schizophrènes place Dadirboukian boulevard Baldachdaf, pavillons psychiatriques, trottoirs et platanes (des mutants), maison des cosmonautes, avenue des sœurs Vandale, secteur Baltimore, avenue Molinari, avenue Mong, rue Zinkorine rue Tolgosane, dortoir Malakassian, institut d’oncologie, maison des sages femmes, etc. Si « le camp psychiatrique est vastissime », si la cité est « le seul endroit du monde à tenir debout », tout cela n’est qu’une minuscule poche sur la carte du globe. Cartographie et syllabaire vont se marier dans la description qui rappelle la succession de plans (avec travellings et différents angles de vue) des films naturalistes. À la fois macro et microcosme, la cité où cohabitent « vivants » et morts devient par métaphore l’image de circonvolutions mentales. Dans cette ville assommée de pluie, dans cet univers dévasté délabré, dans ce néant diluvien, l’atmosphère est plus que délétère, tant sont irrespirables les remugles (bauges secrètes d’araignées, moisissures, vomi, urine entre autres).
Et pourtant le noir est traversé çà et là de trouées lumineuses -ainsi le flash-back (relation amoureuse entre le narrateur et Rebecca) frappe par son lyrisme poétique. Tout comme la narration est ponctuée d’embardées burlesques (il faut imaginer Dame Patmos, son quintal en excès, son onctuosité de phoque, roucouler auprès de Kaytel, il faut entendre ces morts allongés aux étages de l’immeuble de la rue Tolgasane vitupérer ou commenter l’actualité dans une langue à la syntaxe estropiée, au vocabulaire argotique, langue pratiquée aussi par Rebecca et Lola Schnittke, langue des « charretiers de l’espace noir » lugubre sabir d’outre-tombe… De même certains portraits sont ciselés telles des eaux-fortes (Strummheim, récemment décédé se prête à la cérémonie de purification chamanique et sa nudité, ses testicules rabougris, rappellent étrangement des toiles de Rustin). Le couple d’évadés (elle en uniforme de combattant extraterrestre, lui malade mental en oripeaux bleu pervenche trop larges) sort du cadre romanesque pour les planches de Kantor ou Beckett. Le choix des patronymes lui aussi vaut son pesant de références et de jeux de mots !!
Si le « couple », le duo, le « double » est au cœur de la trame narrative : (les deux Breton, Strummheim et son acolyte Bronks, Kaytel et dame Patmos, les deux morts de l’escalier, les deux décédés de fraîche date, Kaytel et Strummheim, les jumeaux Ptak, le narrateur et Rebecca) la dualité ne signifie pas pour autant dichotomie car dans l’univers post-exotique on est simultanément l’un et l’autre, mort et vivant ! L’indistinction vaut aussi pour le rêve et la réalité, la vérité et le mensonge, le passé le présent et le futur.
Dans ce roman aux allures de thriller parfois, à l’écriture dense et alerte tout à la fois, irriguée de combinaisons, références ésotériques, et où se devinent à chaque page le plaisir de la fiction et la tension romanesque, nous assistons bel et bien à la mort de toutes les illusions Sic transit gloria mundi : disparition totale des vivants ou semi-vivants et des morts avec l’immensité translucide de la pluie pour seul paysage. Mort des idéologies (communistes) -dont l’ultime harangue de Rebecca, l’ultime dégénérescence des filles et de Monroe seraient l’illustration.
La longue liste -annexe- où s’exercent la facétie l’auto-dérision l’esprit frondeur et pince-sans-rire de l’auteur - comme ultime pied de nez dans ce
PAYSAGE IMMOBILE ?
-
La part des chiens de Marcus Malte (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Dans ce roman paru en 2003 et réédité, l’auteur nous invite à suivre Zodiak et Roman, dans leur traversée des ténèbres vers la pureté ! Un cheminement faussement chaotique, car le tracé obéira à des cartographies intérieures dont Zodiac a le secret ou la prescience. Une odyssée contemporaine, souvent macabre qui va de rencontres en rencontres, de ravissements en déceptions, de tueries en tueries. Et la construction circulaire (au début et à la fin du roman des formules identiques ou similaires se font écho ainsi que des indications spatio-temporelle) illustre l’infinitude d’une quête toujours recommencée ; éternel retour (quand bien même elle débute pour le lecteur le 927ème jour et se clôt le 947ème)
Il y a un avant… et un après… du roman.
Part des chiens, part des anges. Ombre et Lumière. Le roman déploie cette dichotomie en faisant alterner présent et passé ou en faisant coexister les contraires, en des visions hallucinées ou cauchemardesques, oniriques fantastiques, qui contaminent le style (réalisme cru ou poésie) et les tonalités (gore fantastique lyrique).
Le présent ? Celui des deux comparses, Zodiak et Roman son beau-frère, en marche depuis 927 jours, échoués ce matin-là dans une gare. Ils sont à la recherche de Sonia la funambule, frontière entre terre et ciel, mystérieusement disparue. Arpentant la ville portuaire dans ses bas-fonds ils rencontrent putains matafs, le nabot Igor Pecou, à la recherche d’indices qui, au final les conduiront chez Victor le prince voyou qui possède la ville.
Le passé ? Depuis la rencontre épiphanique de Sonia, jumelle de Roman, au cirque ambulant jusqu’à sa disparition en passant par les tatouages sur le corps de Zodiak dont la peau sera le syllabaire de l’Univers et les épousailles Zodiak Sonia.
Une alternance qui oppose un « ici » celui d’une ville gangrenée par la corruption et l’argent, un « ici » putrescible et un « ailleurs » stellaire et interstellaire scandé par le « chant d’amour » d’un oiseau-lyre ; alternance dont rend compte le traitement stylistique contrasté. Les séquences « flash-back » sont traitées sur le mode lyrique voire romantique ou onirique et contrastent avec la violence -parfois aux limites du supportable- qui précède ou qui va suivre. Un exemple flagrant : voici un chapitre consacré au visionnage d’un film au Palace, salle de cinéma désaffectée, domaine du nabot ; on voit défiler sur l’écran le cirque de l’horreur (sorte de mise en abyme aussi) tant par la monstruosité que l’inhumanité des scènes. Alors que le chapitre suivant évoque avec lyrisme le mariage de Sonia 17 ans et Zodiak 21 ans, en Italie ; et après la longue séquence au Palace, marquée par l’outrance et la grossièreté voici un chapitre d’inspiration bucolique : Sonia caresse, aspire les constellations, lèche et boit les gouttes de pluie qui perlent sur le corps de Zodiak.
Clarté beauté d’un jour nouveau, naissance et renaissance ! une infinité d’interprétations pour chaque chose.
En écho à ces alternances répond la dualité homme/animal. Certains choix lexicaux animalisent l’humain (flair, pâtée, flanc, morsure, crocs ; toi et ton clébard dit fort à propos le nabot (Igor Pécou), Roman et sa gueule de colley.) Mr Victor Maître des lieux, et de Cérémonie connaît bien les hommes ces « misérables petites bêtes à queue » (et l’on imagine un préfet à quatre pattes sodomisé par un labrador, un juge d’instruction léché par cinq jeunes garçons cinq petits porcelets ; moi-même se vante le nabot, je fus le préféré de l’épouse du maire qui me bouffait la queue comme une ogresse). On pourrait multiplier les exemples ! dont le duo Zodiak/Roman serait comme la synthèse : le premier possédait la prescience et Roman un instinct animal, Jésus et Judas à nouveau réunis. Indissociables ! Or Zodiak n’incarne-t-il pas à lui seul deux forces contraires ? (tu sais que tu ne vaux pas mieux que lui (le nabot). On ne possède rien d’autre que ce qu’on détruit, lui murmure sa voix intérieure). De même il sait apprivoiser les chiens à la fois par son langage et son appât (un cœur, des entrailles d’homme… que les femelles engloutissent…)
Si la vie de Roman, Sonia, Zodiak, enfants et adolescents est indissociable du cirque ambulant (avec Giacomo, le poète) dans la vénération du Maître Agharâ, et l’engouement pour les marionnettes de Boban Tze Boba, si le roman obéit à une quête (marche dans les ténèbres vers la pureté l’absolu l’amour ? ce que revendique Zodiac (il pensait à son amour, il était déterminé, il était en marche ; retrouver son amour, l’emporter avec lui, être à jamais son unique demeure) ne pourrait-on pas, mutatis mutandis, voir en Marcus Malte un aède, un rhapsode des temps modernes (les horreurs rapportées rivalisent avec celles de l’Iliade) ? Contorsionniste de la « voix » il adopte tous les registres (réalisme cru, poésie, fantastique) il mélange les genres -baroque épique fantastique horrifique lyrique-, il sait peindre à la Bosch massacres et tueries, il tisse en entrelacs l’interpénétration des règnes et des espèces, par une alchimie qui renvoie à d’antiques cosmogonies.
Une volubilité au service d’une peinture de l’ignominie et du beau ! Et parce que les mots sont pauvres on en parle avec des gestes.
Après tout, la vie des humains n’est-elle pas une sordide arène de cirque où scintillent çà et là des perles incandescentes ?
-
Les orages de Sylvain Prudhomme (éditions L’arbalète Gallimard)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Dans Les orages, composé de treize « histoires », Sylvain Prudhomme évoque ces moments de la vie, ces instants décisifs à partir desquels tout va basculer, ce que suggère d’ailleurs l’exergue emprunté à Frederico Fellini « Quel est ce bonheur qui me fait trembler qui me redonne force et vie ? Je me sens délivré. Tout a un sens » (8 ½). Une référence à la fois thématique et esthétique ! Explorer les limbes de l’esprit, le chaos intérieur, mettre à nu une fêlure, avant cette (re)naissance définitive -celle du créateur, celle de tout être humain ? Sobre, malicieuse parfois, l’écriture sera en harmonie avec chacun des personnages, pris dans la tourmente de ses turbulences, personnage rarement identifié par un prénom ou un nom, tant l’événement/avènement aurait un caractère intemporel.
Ecoutons cette polyphonie.
Qu’il s’agisse de crises intimes, celle du couple (L’île), de son délitement (L’appartement), de la difficulté à faire le deuil d’une fausse couche (la nuit), qu’il s’agisse du deuil (cendres), de la dégénérescence cognitive (le taille-haie), de la maladie (la vague), de la peur de la mort (mention particulière ici à ce personnage de La Tombe qui pendant 40 ans sera le comptable/épicier sinistre, de sa propre vie…), l’auteur met en scène des êtres face à leurs orages intérieurs, à leurs turbulences, des êtres « sur la brèche », car c’est une même dynamique qui sous-tend l’ensemble de ces treize « histoires », celle de l’hapax existentiel que Jankélévitch avait défini bien avant Onfray. Il s’agit des moments de la vie qui n'arrivent qu'une seule fois et où l’on comprend que la vie bascule. Ainsi Ehlmann que le lecteur rencontre en même temps que le narrateur (souvenir de la lumière) évoque sans pathos mais avec une sidérante et confondante justesse les deux semaines passées à l’hôpital auprès de son enfant entre la vie et la mort, chambre 817 et surtout ce jour du 20 septembre 2013 qui a changé sa vie… Dans la nuit après un court préambule -telles des didascalies- une jeune femme va « raconter », se raconter, et son récit est d’autant plus poignant qu’il est tout en pudeur même si la fin est exaltée « je me sens sorcière je me sens chamane unie à la mer toute-puissante par une nuit sans lune ».
Sylvain Prudhomme fait entendre des bruissements, des frémissements, des murmures ou des colères. Et chaque « histoire » a sa tonalité propre comme si l’auteur ayant pénétré les arcanes d’un « moi » profond les avait faits siens. Un travail de « restitution » quelle que soit l’instance narrative choisie (première ou troisième personne) ou le mode de narration (procédés d’enchevêtrement, récit dans le récit, effets de mise en abyme). Le plus spectaculaire, à mon avis, est Awa beauté (une nouvelle éditée spécialement par Initiales en novembre 2017). Le découpage en cinq mouvements, la disposition typographique (phrases courtes ou nominales détachées), les choix lexicaux, les rites ancrés dans la culture sénégalaise, les ambiances, le thème du sacrifice exhaussent ce « micro récit » au rang de tragédie. Dans Souvenir de la lumière nous entendons comme une polyphonie en abyme : des voix se font entendre, celle du narrateur qui rapporte les propos d’Ehlmann, celle de l’infirmière, elles se superposent et le procédé choisi va de pair avec une évocation en entrelacs, avec des échos des glissements, des fondus enchaînés. Or ce sera l’unique fois où le narrateur aura rencontré le personnage principal, tout comme ce dernier aura vécu l’unique fois où sa vie allait définitivement changer, et ce n’est pas pur hasard si cette « histoire » sert d’ouverture à l’ensemble, comme si elle contenait déjà le tout. Et d’ailleurs A, la femme d’Ehlmann, nous allons la retrouver dans la troisième « histoire » (les voisins) elle sera très présente dans « l’appartement » et « la tombe ». Tout cela donne à penser que l’ensemble des « Orages » est moins un « recueil » de morceaux éclatés qu’un continuum où les « histoires » se croisent (chacune avec sa spécificité). Ce qui conforte une telle approche est précisément la référence à Fellini. Cité en exergue (l’extrait dit l’accalmie définitive après l’orage) Fellini est le titre de la douzième « histoire ». Un personnage regarde un film de Fellini (8 ½ ) le commente revient en arrière… et au cours du récit « l’homme qui est assis » semble se confondre avec « l’homme qui ne sait plus ce qu’il veut, à cet instant précis » étant lui-même celui qui essaie de faire un film et « qui à cet instant sait moins que jamais ce qu’il veut » ; et l’homme qui était assis est en fait un écrivain qui ne sait jamais bien à « quoi il veut que son roman ressemble ». Ne pourrait-on mettre en parallèle la composition de ce récit, mise en abyme lui-même du film, avec la composition des Orages ? Jeux de miroir, de « faux semblants » aussi dont Balzac était l’illustration. Voici un coin rêvé pour abriter les amours clandestines du narrateur, le Paradis (entre Mantes-la-Jolie et Conflans-Sainte-Honorine) voici un café où s’attablait régulièrement un « écrivain » (qu’on surnomma de ce fait Balzac) et… que le narrateur sera amené à revoir, sept années plus tard, seul buvant au Temps, à ses galeries secrètes ses doubles fonds, ses chemins secrets »
Que la « chute » de chacune de ces 13 histoires soit comme une épiphanie, cela était annoncé dès l’exergue ou même suggéré dès le titre du récit liminaire « souvenir de lumière ». Ce qui n’exclut pas l’humour. Tout est bien sert ainsi d’épitaphe à La Tombe ….
Les orages, un terme générique aux multiples connotations !
Les orages des instantanés de vie au frémissement solaire !
-
"Adultère" d’Yves Ravey (éditions de Minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Le personnage-narrateur d’Adultère tient une station-service (qui vient d’être déclarée en faillite) sur une route nationale en Franche-Comté. Patron, il doit gérer des problèmes financiers (indemnité de licenciement pour le veilleur de nuit-mécanicien, Ousmane) ; époux, il soupçonne sa femme Remedios de le « tromper » avec Walden, le président du tribunal de commerce… Victime d’un double échec ? « Alors il va employer les grands moyens »….
Comme souvent chez Yves Ravey le personnage-narrateur en rapportant les faits s’exprime au passé composé, ce qui autorise une mise à distance du « je », c’est-à-dire l’extériorité du sujet par rapport à lui-même et à tout ce qu’il voit et entend ; en vivant les événements avec une apparente indifférence Jean Seghers serait-il incapable d’adhérer au réel ? Ce que confirmerait l’incipit.
On sait que l’incipit chez Yves Ravey a une valeur suggestive tout en contenant des éléments informatifs nécessaires à la narration. Le roman s’ouvre sur le portrait de Remedios fêtant la veille notre anniversaire de mariage. Contemplant la photo de sa femme et la comparant à celle de leurs fiançailles, Jean Seghers veut se persuader que le temps (écart de dix ans) n’a pas eu prise sur le réel (beauté de l’épouse, solidité du couple -emploi du pronom « nous ») ; portrait qui -comme tous les personnages du roman- subira les effets collatéraux de l’incendie. Mais d’emblée n’est-ce pas notre rapport à l’image qui est évoqué ? L’image comme support du réel, réel vécu ou fantasmé ? Ici plus précisément ne serait-ce pas la nostalgie d’un passé édénique (Venise), ou du moins supposé tel, qui se heurterait au double échec du présent ?
Si des indices temporels -placés en début de chapitre- ponctuent le récit (cette nuit-là, à la fin de l’après-midi, le soir même, le dimanche, le samedi suivant, cette nuit-là, le lendemain, le dimanche), ils créent des effets de resserrement et de dilatation, surtout à partir du moment où « entre en scène » Brigitte Hunter, (experte en assurances) qui relaie l’adjudant Bozonet (lequel dans un premier temps veut « bâcler » l’enquête et conclure à un incendie accidentel, avant un sursaut final…). Et plus l’étau se resserre autour de Jean Seghers plus le temps est minuté dans sa troublante mécanique. C’est qu’après une autre « découverte » (le « véritable » amant de Remedios, ou « supposé » tel) il a élaboré les phases d’un projet criminel. Tout se passe comme prévu, il simule, observe, manipule et, triomphaliste, peut avouer « tout se passe dans l’ordre souhaité ». Mais c’est sans compter sur la ténacité de B. Hunter (qui rappelle étrangement l’inspecteur Costa du roman précédent « Pas dupe » avec cette manie de fureter partout, de ne négliger aucun détail jusqu’au harcèlement). Et voici que s’opère une première inversion. Lui l’observateur (et tout un champ lexical renvoyait au thème du regard) se sent désormais « observé », lui le naïf marionnettiste doit se rendre à l’évidence « les histoires d’incendie c’est dans la tête des gens que ça se passe, parfois suffit d’un détail pour provoquer l’étincelle ». Ses arguments prétextes ne résistent plus à une autre mécanique, mieux huilée ; « la présence de cette femme indiquait le début de mes ennuis ». Il est devenu la proie que l’on traque, malgré ses dénégations et ses tentatives de « divertissement », « je vais découvrir une défaillance dans votre raisonnement », « je crains que vos affirmations ne se retournent un jour contre vous » affirme sans ambages l’experte en assurances.
Et son constat « vous laissez derrière vous, Seghers, quantité de petites phrases souvent très vagues, sujettes à interprétation » ne résonne-t-il pas comme une mise en abyme de tout le roman ? Roman dans lequel l’auteur joue avec les « fausses pistes » et les retournements de situation jusqu’aux révélations finales à valeur de « coda » !
Le roman est traversé d’effets spéculaires déclinés dans une sorte de prisme qui les renvoie presque ad libitum : l’image et la représentation du réel, le miroir et son reflet comme écran sur lequel on projette des attentes, les images mentales et leur impact, la faillite annoncée et la disparition de la station, Hunter double de Seghers (enquêteurs), Hunter et Bozonet, Walden/Valerio, au couple, Remedios/Jean correspondent les couples Ousmane/Amina, Dolorès/Salazare et jusqu’à ce bijou détourné de sa fonction initiale (gage d’amour) devenu valeur d’échange et qui emprisonne un « trio » !
On pourrait s’interroger aussi sur le choix des prénoms et des noms (Seghers, Remedios, Walden, Hunter) qui renvoient à des références cinématographiques et culturelles (on sait que l’auteur y est particulièrement sensible mais que souvent les connotations sont décalées par rapport à ses anti-héros) de même que sur la thématique récurrente de l’argent (omniprésente dans l’œuvre du romancier).
« Vous me donnez l’impression d’un homme qui perd la partie avec sa femme »
Et si le réel -entendons le vécu de la fiction- déjouait ces impressions ?
Une fois de plus Yves Ravey aura séduit son lecteur par ce qu’il est bien convenu d’appeler son « identité stylistique » : "dramaturgie" finement ciselée sous les apparences de la banalité et de la linéarité, art de l'épure et de la contention, art du "récit" (temps dilaté ou étréci, intrigue mouvante, personnage moteur de l’action et pourtant comme « hors-jeu » par la froide distance de l’écriture, ambiances qui rappellent E. Hopper, la femme « apparition » accoudée au bar)
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact






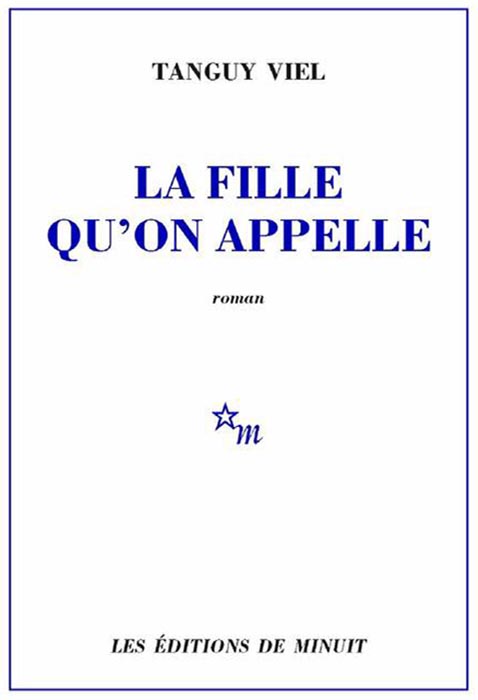
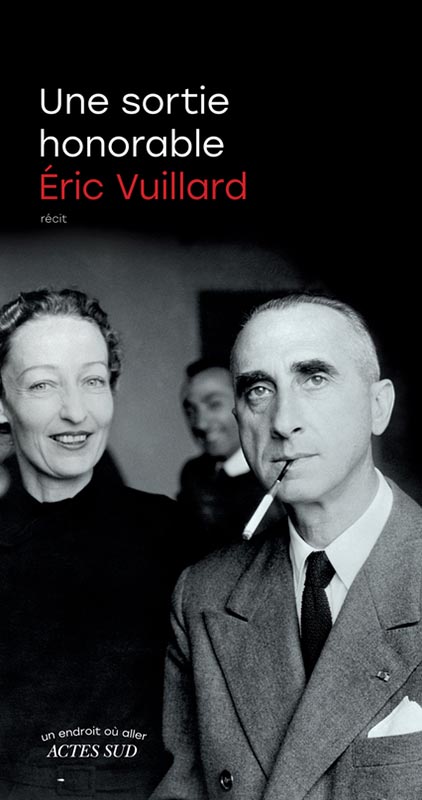
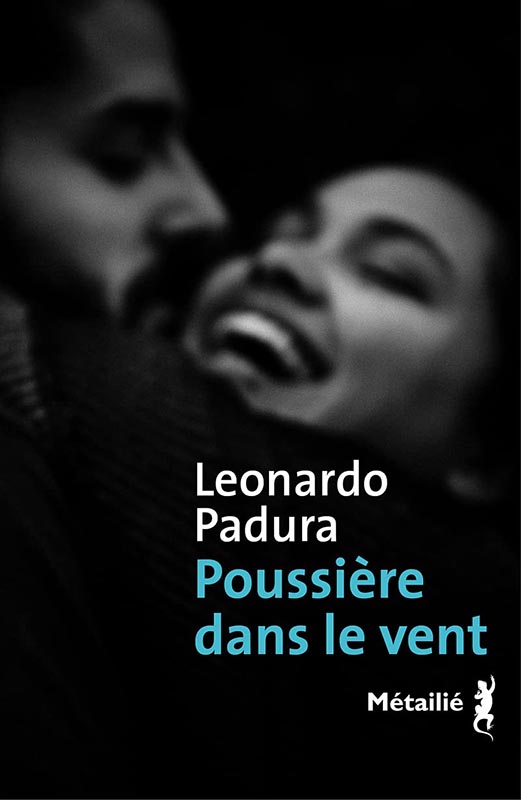
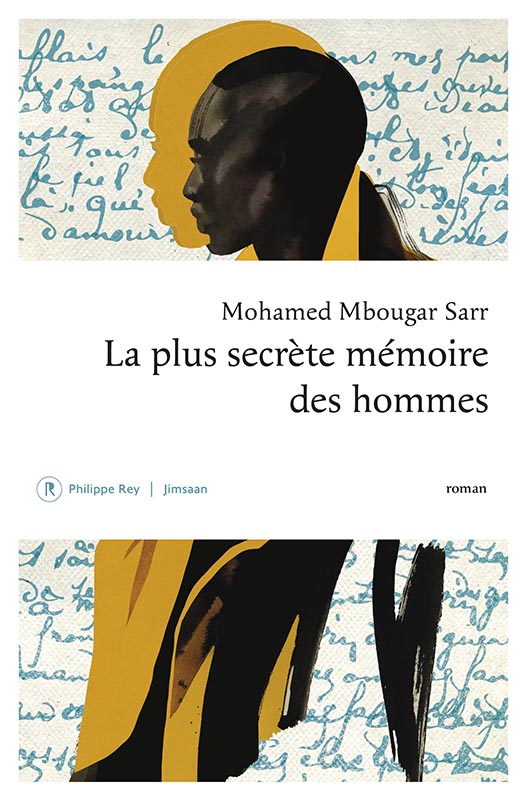
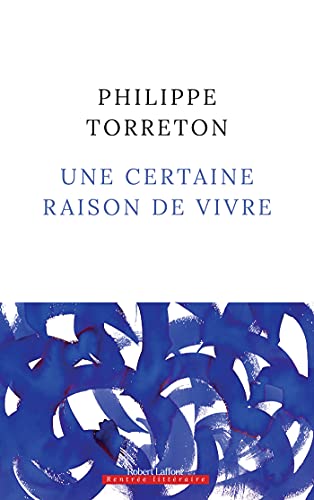
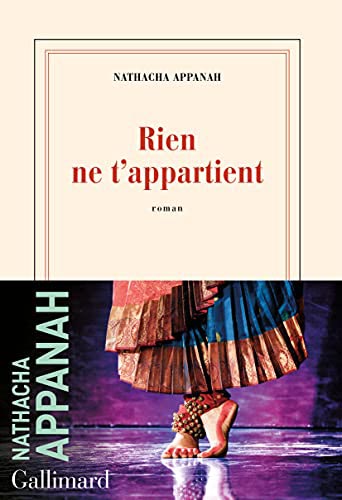
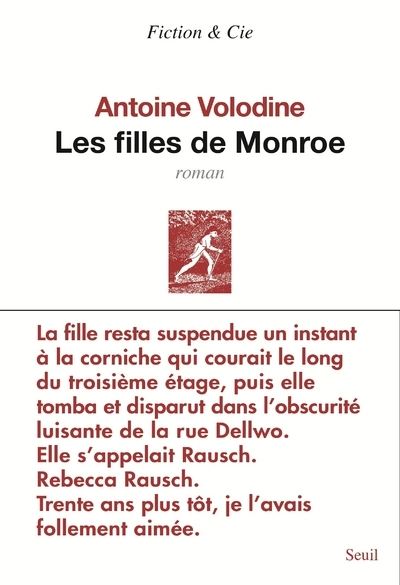


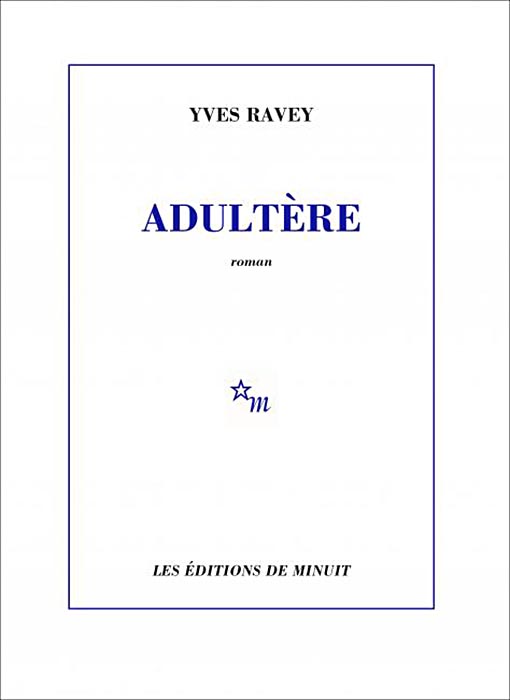
![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)