Littérature
Critiques littéraires
-
"Francis Rissin" de Martin Mongin (éditions Tusitala)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
De qui Francis Rissin serait-il le nom ? Ce personnage de fiction -qui échappe d’ailleurs à son auteur...- est censé incarner le Sauveur, celui qui délivrera une France qui va mal, écœurée par des décenniesde compromis et compromissions… Au tout début un nom ; un nom de 13 lettres qui progressivement s’incarne, prend consistance, tout en se dérobant ! Le lecteur est invité à participer à une « traque » -qui est aussi celle d’un inconscient collectif- entraîné dans un mouvement labyrinthique, scandé par onze approches aux registres et styles différents. Ce roman -fable politique où se mêlent gravité et humour- est aussi un questionnement sur l’acte de créer, sur l’objet littéraire. Martin Mongin serait-il le rhapsode des temps modernes ? Francis Rissin notre « rédempteur » ?
Ce roman est composé de onze chapitres -dont les titres sont censés se référer à des sources vérifiables- assez courts pour ne pas anesthésier la spécificité de chaque « genre » et de chaque style : on passe ainsi d’une conférence universitaire à une enquête policière, du journal intime à des rapports « officiels », de l’autobiographie à des compte-rendus hospitaliers de la confession à des quêtes enquêtes contre-enquêtes, et un chapitre contient même le script d’un long métrage... La structure interne obéit aussi à un double mouvement -dont le chapitre 6 serait le pivot- les cinq premierschapitres approcheraient le nom, jusqu’au chapitre six, le journal intime où on est au plus près du personnage. Les cinq chapitres suivants, c’est le mouvement inverse, il se délite (propos de l’auteur). Et d’un mouvement à l’autre se dessinent des effets spéculaires, même si les « onze pièces fonctionnent comme autant de plans de réalité distincts » (Avertissement)
Convoquant des genres et registres divers, l’auteur s’en s’approprie les codes tout en les parodiant !! (roman autobiographique et roman d’initiation par exemple). Autant d’approches (littéraire, politique, sociale et autres) d’un personnage aussi imprévisible qu’insaisissable. Car Francis Rissin c’est un clone (multiplication des affiches et don d’ubiquité) c’est un criminel (sans état d’âme il procède à l’élimination de qui entrave son ascension..) c’est un chef d’état (élu grâce à une manipulation des esprits que relaie une presse complaisante) c’est un beauf !!Complice, le lecteur assiste à des séquences hallucinées (on retiendra le vernissage à Beaubourg) ; passager clandestin, il accompagne Sirac au volant de sa Laguna sillonnant toute la France rurale (dont le romancier se fait le peintre). Et cela sur un fond politique précis, vérifiable: émeutes grèves. Un pays malade. Un pays en attente d’un homme providentiel qui le délivrerait de la chienlit ? Ou du moins s’agit-il des velléités de ceux qui attendent un « homme de poigne » un chef qui a la trique et qui… rétablirait la peine de mort par exemple...
Cet « objet » littéraire peu convenu se mue en une vision futuriste et fantastique - ancrée dans le Réel, et qui refuserait l’allégeance sans faille à la religion- ;et ce, grâce à la liberté de ton, au sens de l’image et du rythme, à la variété des registres et à l’omniprésence d’un humour froid noir ou grinçant. Convoquant des personnages bien identifiés, -qui ont réellement existé ou qui sont encore vivants et qui nous sont plus ou moins familiers (architectes, romanciers, peintres, artistes, hommes politiques)- l’auteur « expérimente » aussi -dans le sillage de Laurent Binet?- les relations de la fiction à la réalité, du récit à l’interprétation par une subversion des codes et des genres. Décontextualiser le factuel et le (re)contextualiser dans (et par) la fiction ?
« La littérature commence avec Homère et toute grande œuvre est soit une Iliade soit une Odyssée » cette phrase de Raymond Queneau que rappelle Catherine Joule dans son séminaire du 3 septembre (chapitre 1) permet au romancier de « situer » Francis Rissin (ou du moins le pré- texte Approche de Francis Rissin) dans une « zone » intermédiaire « intervallaire, indécise et nébuleuse ». Si le personnage n’existe pas, les tentatives littéraires – polar, fantastique, épopée, roman d’initiation, roman politique – seraient-elles, elles aussi, frappées d’inanité ? Et que devient le rapport auteur/lecteur ? (Un pacte loin d’être rompu d’ailleurs, au contraire). Lecteur apostrophé, confident et témoin de Francis Rissin (de ses avatars) pris au piège de la création ? … Lecteur à même de signaler ici et là des longueurs et/ou des redondances inutiles (tout comme Terrast qui, d’un ton docte et solennel imitant les évangélistes, s’excuse de ses digressions…).
New York Lawyers North Carolina Lawyers North Dakota Lawyers Ohio Lawyers Oklahoma Lawyers Oregon Lawyers Pennsylvania Lawyers Rhode Island Lawyers South Carolina Lawyers South Dakota Lawyers Tennessee Lawyers Texas Lawyers Utah Lawyers Vermont Lawyers Virginia Lawyers Washington Lawyers West Virginia Lawyers Wisconsin Lawyers Wyoming Lawyers Washington, DC Lawyers Personal Injury Lawyers Criminal Law Lawyers DUI & DWI Lawyers Consumer Law Lawyers Employment Lawyers Family Law Lawyers Estate Planing Lawyers Divorce Lawyers Lawyers Tax Law Lawyers Medical Malpractice Lawyers
Remonter vers ce qui tisse le processus du geste : « reconstituer la scène inaugurale, moment où le texte a été élaboré : cette démarche revendiquée par Catherine Joule, cette universitaire, que l’on retrouvera « convertie » en psy au chapitre 8, est aussi celle de Terrast (chapitre 11) alias Sergent (chapitre 10) alias ??D’abord il n’y avait rien et l’instant d’après il était là. Miracle de la Création ! Même si la vie de Francis Rissin est un livre qui n’existe pas, une épopée qui n’ pas eu lieu, le roman de Martin Mongin -qui en rend compte- est truffé de références à la mythologie grecque -ses personnages sont comme les descendants des Ajax Achille Ulysse... Terrast n’avoue-t-il pas que non seulement les livres l’ont sauvé (lui et ses potes, au Centre de Florac) mais qu’Homère est devenu leur seul maître...
Présence prégnante d’un être qui existe en se dérobant ou qui n’existe pas, créé par un auteur contorsionniste du langage qui adopte tous les registres, (réalisme cru, poésie, fantastique), mélange les genres (baroque, épique) parodie la Bible : Oui Francis Rissin est une œuvre ludique à l’extravagance maîtrisée
Francis Rissin : une œuvre prémonitoire ??
« Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui pense à la France ? » Cette question, le personnage, venimeux, l’adresse au Sénat et à l’Assemblée nationale, au moment où il est prêt à donner un grand coup de balai dans un pays transformé en hôtel de passe VIP - Extraite de son (prétendu) journal (chapitre 6) et citée en exergue, ne résonne-t-elle pas comme une admonition ou du moins un avertissement ?
-
"Ici n'est plus ici" de Tommy ORANGE (Editions Albin Michel)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l'américain par Stéphane Roques
Éblouissant, ce premier roman de Tommy Orange (né en 1982 à Oakland) tant par sa construction -un chœur de douze voix, des destins individuels qui convergent dans le grand rassemblement du pow-wow-, que par les ressources de sa langue, - qui mêle plusieurs registres - et l'ambition de son sujet -la quête d’identité et d’appartenance. Une geste, celle des Indiens urbains d’Oakland, comme support à une méditation et à une revendication.
Le lecteur est invité, avant d’entrer dans la fiction, à se rappeler (ou tout simplement découvrir) ce que fut l’existence des Indiens : massacres, génocide, récupération, euphémisation, clichés... C’est le prologue (auquel fera écho le chapitre « entracte » dans la deuxième partie Réclamation) Oui « des confins du nord du Canada au nord de l’Alaska jusqu’à la pointe de l’Amérique du Sud les Indiens ont été éliminés puis réduits à l’état de créatures à plumes » « Nous amener en ville était l’étape finale de notre assimilation, […] l’achèvement de cinq cents ans de campagne génocidaire. La ville nous a renouvelés… Nous nous la sommes appropriée.
Dès lors le romancier peut donner la parole à des Indiens urbains. Écoutons-les !
Voici des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes. À travers leurs témoignages d’abord juxtaposés, individualisés, le lecteur établira bien vite des connections, liens de parenté ou de connivence. Si la diversité des instances narratives (« je » « il » ou encore « tu » pour Thomas Frank), des âges et des expériences vécues, fait du roman une sorte d’épopée polyphonique, la diversitén’estqu’apparente. Fragmentation, morcellement pour mieux appréhender l’humain et faire des événements relatés (nombreux flash-back) le lieu où se rencontrent des destinées. Tous les personnages du roman semblent porter des stigmates liés à la pauvreté, l’alcool, le chômage, l’abandon, le suicide, la prison. Et ce n’est pas pur hasard si Tony Loneman, 21 ans, est le premier à prendre la parole : son visage élimé, le Drome, est le signe du « syndrome d’alcoolisation fœtale » et ce qu’il raconte peut se lire comme une mise en abyme : préparation du pow-wow, bienveillance d’une grand-mère, croyance en la « boîte-médecine », importance du regard (qui sera repris en leitmotiv et décliné dans toutes ses connotations (tenter de voir autre chose que ce dont on a affublé les Indiens) Les gens « détournent les yeux quand ils voient que je vois qu’ils me voient ». Pour un Blanc ne peut être Indien que celui qui porte des plumes (et à un moment Orvil, petit-fils de Jacquie, est fier de se parer du costume pour interpréter une « danse indienne » il a répété en regardant des danses sur YouTube, mais en cachette car sa grand tante Opale lui a dit et répété « tu es Indien parce que tu es Indien, parce que tu es Indien….Ce premier chapitre est aussi prélude, annonciateur de la tragédie ; Tony va participer avec Octavio et d’autres comparses à un braquage au pow-wow (or une balle qui transperce et fait un trou, ne représente-t-elle pas, par métonymie, toutes ces balles qui ont parcouru des années…pour exterminer tout un peuple, une mort programmée). Le pow-wow, c'est sur cette scène, à la manière du théâtre antique, que va se jouer la tragédie, condensé d'une violence engrangée depuis deux siècles et figurant la mort programmée d'un peuple
Dene Oxendene le deuxième à prendre la parole, n’est-il pas le « double » du romancier ? Ou du moins son porte-parole ? (même si de l’aveu de l’auteur chaque personnage est une parcelle de lui-même). Membre des tribus Cheyenne et Arapaho, il veut « attester de l’histoire de certains Indiens d’Oakland, collecter leurs témoignages, Il est convaincu que les histoires individuelles ne sont pas pitoyables, mais pleines d’une vraie passion, d’une rage. Et c’est précisément cette énergie, cette rage qui anime les différents personnages du roman quand ils sont en butte à leur passé qui les a cabossés ou confrontés à leur présent, dans leur besoin irrépressible de reconnaissance. Emmurés dans l’Histoire et l’Histoire emmurée en eux (citation de Baldwin). Thomas Frank résume une situation douloureuse partagée par les Indiens au sang mêlé « le fardeau que tu portes vient du fait que tu es né à Oakland. Un fardeau de béton, lourd d’un seul côté, la moitié qui n’est pas blanche...Tu viens d’un peuple qui a volé, encore et encore et encore. Et d’un peuple qui a été volé. Quand tu prenais un bain tu regardais tes bras cuivrés sur tes jambes blanches et tu te demandais comment ils pouvaient être attachés au même corps »
Dans la dernière partie du roman, le rythme s’accélère ; tous les personnages (avec lesquels on a sympathisé et dont on connaît les motivations) sont réunis au Coliseum pour le pow-wow. Les chapitres de plus en plus courts font se succéder de façon vertigineuse les différents points de vue ; la phrase elle-même se met à crépiter comme si elle imitait le tracé des balles ou une caméra qui virevolte. Les plans et angles de vue en un fabuleux montage créent un final époustouflant où la parole semble survivre au corps qui agonise…
Le titre de ce premier roman est emprunté à Gertrud Stein (Autobiographie d’Alice Toklas) : There is no there, there C’est la disparition de l’Oakland rural de son enfance ! Dene qui n’a pas lu Gertrud Stein en dehors de cette citation sait que pour les autochtones de ce pays partout aux Amériques se sont développés sur une terre ancestrale enfouie le verre le béton le fer l’acier, une mémoire ensevelie et irrécupérable. Il n’y a pas de là, là : ici n’est plus ici...
Or, Il ne faut jamais s’abstenir de raconter notre histoire et personne n’est trop jeune pour l’entendre. Nous sommes là à cause d’un mensonge, avait confié la mère à sa jeune enfant Opale alors qu’elles étaient sur l’île d’Alcatraz - occupée par les Amérindiens de 1969 à 1971
Ici n’est plus ici un flux mémoriel choral et syncopé, que ponctuent d’abondantes références littéraires
Ici n’est plus ici un roman engagé et décapant, noir et lumineux
-
"Aires" de Marcus Malte (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Lundi 6 août. Chaleur caniculaire. Nous embarquons à bord de différents véhicules. On the road again. L’habitacle de la voiture devient par métaphore celui des pensées. Les voix intérieures dialoguent avec le crépitement des infos, des chansons et des slogans publicitaires. Et voici qu’en disant le monde – celui d’une ère censée être révolue...- l’auteur le déroule, le déploie, ancre l’Histoire dans les histoires -ou l’inverse- car c’est bien d’un chassé croisé multiforme et/ou de télescopage qu’il s’agit dans cet « état des lieux »… Tout comme il a fait s’enchevêtrer, se repousser, se croiser, des micro histoires d’abord parallèles.
Une écriture polyphonique, le recours à toutes les ressources du langage et de la typographie, des enchâssements de récits avec mises en abyme, un mélange d’humour, de cynisme et d’amertume : tel se donne à lire, entendre Aires le roman de Marcus Malte
Le roman s’ouvre sur un prologue à la police spécifique et au style déroutant (ex cybero sum). Prologue auquel répondra en écho un épilogue. Un narrateur -double de l’auteur- professeur de l’ère nouvelle s’adresse à des aspirants graduates juvides et nubies Il explique la genèse de son projet : comprendre sur quel tas de fumier a poussé la rose, et annonce ce qui va apparaître sur le portail relater dans le dialecte originel une seule journée une longue séquence du premier cent du troisième mil ante reset. De même le ton est donné : celui de la raillerie caustique - celle qui vilipende les travers de notre société, une société qui a détruit la planète, laissé crever l’ozone contraignant les héritiers à vivre sous une cloche étanche… Dies irae. Dernier jour de l’ère « vroum-vroum »
Lecteur (avant le Jour d’après) et auditeurs bachelors aposters (de l’ère nouvelle) vont se confondre...
Marque du véhicule, kilométrage au départ et à l’arrivée, cote argus : le titre des trente trois chapitres qui composent le roman est une fiche signalétique ; la voiture commeinstrument de valuation. L’humain serait-il relégué au second plan...dans le monde chosifié des apparences ?. Et pourtant la plupart des personnages suscitent l’empathie voire la compassion. Voici entre autres Roland qui « roule » vers celle qui fut l’amour de sa vie, (si tu meurs Rolande je meurs), Sylvain qui conduit son petit Juju à Disneyland, Zoé -la croyante- qui travaille à la cafétéria de l’Arche, le couple Gruson septuagénaire qui se chamaille mais qui a gardé intacte la verve de leur 20 ans ; leur fils Frédéric chauffeur de poids lourd qui ne pense qu’à sa fille Océane, Claire et Jean-Yves Jourde un couple en rupture... Ils ont chacun une histoire et des flash-back plus ou moins longs en restituent les jalons. Les strates de leur passé qui se marie avec celui de l’Histoire (récente ou plus ancienne) créent un entrelacs d’échos, de glissements, de superpositions de fondus enchaînés (illustrés d’ailleurs par les changements de police ou de tonalité) ; un texte foisonnant protéiforme, qui renoue avec certaines traditions littéraires. Habitacle et vagabondage de l’esprit, habitacle et prise de conscience. Circonvolutions de la pensée et défilement sur l’asphalte. Pauses -les fameuses aires de repos- chemins de déviation- sorties ou plutôt marches arrière (pour comprendre le passé ?) Espace calligraphié et paysage intérieur ?Simultanément émergent tous les travers d’une société, -certains avaient été répertoriés dès le prologue. Les informations diffusées nous renseignent tant sur des faits divers dont certains assez glauques que sur des données économiques quand il ne s’agit pas de la presse dite people. Et comme le romancier a cherché le ton juste pour chacun des protagonistes (tics de langage, vocabulaire) Aires s’écoute comme une polyphonie. Celle de parcours dissemblables cahoteux ou pathétiques qui « roulent » sur le revêtement uniforme gluant entre 7h54 et 15h18, en ce lundi 6 août. La vie des gens avant le Jour d’après… avec leurs joies dérisoires leurs espoirs insensés leurs fêlures et déficiences
Un texte vibrionnant (sans connotation négative) à la verve satirique mordante, une écriture pleine d’allant qui pour éviter l’assomption de la complexité autant que la simplicité d’un rendu univoque, met en valeur un dispositif littéraire au service d’une réalité multiforme. La variété des formes de narration (récit, dialogues, histoire, cahiers à la chronologie éclatée) des registres (dramatique comique poétique même cf certains extraits des cahiers ou les rêves éveillés de Fédéric) des tonalités (humour, ironie, pathétique) des styles, de la typographie (polices italique caractères gras) et le sens aigu du détail en témoignent aisément. Et sans perdre de vue le statut inaugural, (un maître et ses aspirants graduates) le roman est ponctué par de brèves intrusions du narrateur (recommandations et commentaires qui s’adressent autant au lecteur du XXI° siècle qu’aux bachelors des temps futurs). Humour et autodérision quand l’auteur s’interroge sur la fonction, le métier d’écrivain et qu’il cite ses « confrères ». On devine aussi le plaisir du romancier à ciseler certains portraits telles des eaux-fortes (cf. les participants à la 99° session de l’OIT à Genève en 2010)
Comparable à un passager clandestin anonyme, le lecteur aurait-il quelque accointance avec l’auto-stoppeur sans identité, celui qui a brandi sa pancarte « Ailleurs » ? d’abord refusé par Catherine qui conduit (mal) une Lexus LS III puis accepté par Fred à bord de son camion fourgon Scania R114
Spectateur, ne vient-il pas d’assister à une Ronde des Temps Modernes….projetée sur l’écran des Vanités ?
Aïeux si différents et tellement semblables, nos frères
Assurément humain
-
"Girl" de Edna O'Brien (Editions Sabine Wespieser)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Roman traduit de l’anglais -Irlande- par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat
Avril 2014 : 276 lycéennes de 12 à 16 ans sont enlevées par Boko Haram au Nigeria (Chibok). Pendant trois ans la romancière irlandaise Edna O’Brien a mené une « enquête » (elle a interrogé des ex-captives, a rencontré des médecins, des représentants d’ONG, des religieux et des religieuses). En s’emparant de cette tragédie, elle rend lisible l’indicible en épousant le point de vue de la jeune Maryam (la madone noire). Elle invite ainsi le lecteur à suivre le chemin de croix de cette adolescente depuis son enlèvement jusqu’à son retour -où commencera d’ailleurs un autre enfer…
Ô femme-enfant au corps dépecé, à la parole confisquée que l’écriture d’Edna O’Brien ressuscite dans une langue où se mêlent réalisme et poésie, dialogues et récit et où le rythme épouse souvent la course pour la survie.
Écoutons ce monologue bouleversant, celui d’un destin brisé, celui de victime sacrificielle, incarnée désormais dans le Verbe ! Mais un verbe qui sait garder intact l’émerveillement devant une étoile ou un insecte sur le mur des supplices…
« J’étais une fille autrefois, c’est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier » Un tel incipit frappe comme un uppercut émotionnel ! En quelques mots simples et glaçants le hurlement oppose un « avant » que l’on suppose lumineux (emploi de l’imparfait et constat sans appel « c’est fini ») à un « maintenant » purulent et irréversible ! (emploi du présent, champ lexical de l’avilissement, de la putréfaction).
Un avant revisité au cours du récit, par des flash-back (le dancing, les yeux du frère Youssouf, l’amour des parents...) qui, - échappés de lumière-, sont le contrepoint à l’horreur du quotidien. Un quotidien fait de tourments, d’humiliations -l’enlèvement à l’école, les tâches et prières imposées, les viols, les grossesses, les mariages avec les djihadistes. Et surtout cette détestation de soi. Et pourtant -malgré les yeux qui saignent, malgré la dislocation de l’être - quelle ténacité, quel acharnement à se « reconstruire » ! Une fuite avec son bébé Babby, une course contre la montre ; si frêle si fragile et pourtant si courageuse pour affronter l’inconnu le plus périlleux (le troupeau a fui vers où l’herbe est plus tendre, a fui le carnage et le fléau) et parfois la tentation d’en finir... Interrogée à un poste militaire Maryam résume en un paragraphe saisissant tout ce qu’elle a enduré, paragraphe scandé par « je dis » « je raconte » « je décris ». Mais l’aveu « je ne dis rien des sauvageries dans la maison Bleue » (en écho plus tard à sa mère « ne me demande rien » et face au psy « je lui dis des choses pour ne pas lui dire des choses ») prouve que la romancière fait de Maryam le sujet de sa propre vie : la jeune fille (girl) dira ce qu’elle veut bien dire ; en revanche la narratrice Maryam aura fait du lecteur son unique complice et ne lui aura rien épargné ; la trivialité toutefois est bannie dans le rendu de scènes au réalisme foudroyant : ainsi les viols et leur sordidité sont vécus de l’intérieur « j’ai eu l’impression d’être poignardée et encore poignardée », « une boucherie s’accomplit en moi », « nous étions trop jeunes pour savoir ce qui s’était passé ou lui donner un nom », « j’ai dit au revoir à mes parents et à tous ceux que je connaissais ». Déchirure fêlure indélébiles !
Dans l’avant-dernier mouvement (retour au village dans la famille) Maryam doit affronter une réalité insoupçonnée : elle, la victime, est désormais une coupable : l’Oncle, la mère, les habitants, tous la méprisent (n’est-elle pas la femme du bush, elle par qui le scandale est arrivé, elle la responsable de la mort du père et du frère, elle qui désormais souille la communauté ? Figée au même endroit où l’avait attendue vainement le père, elle attend Babby cet enfant confisqué et voué à disparaître (comme ces agneaux qui bêlent leurs derniers souffles en allant vers l’abattoir) ! Mais par un « retournement » de situation, Maryam accueillie au couvent, pourra contempler un ciel, dôme d’or de bout en bout d’un éclat si vif qu’on aurait dit que le monde était au seuil d’une nouvelle création.
À la fin du roman -qui est aussi la fin d’un parcours tortueux et torturant- Maryam peut saluer l’Aube nouvelle. Inscrivant son destin dans celui de l’univers tout entier, n’accède-t-elle pas au panthéon des héroïnes de tragédie qui ont marqué la littérature ?
Par-delà le cas particulier de Maryam, n’est-ce pas l’ensemble des jeunes femmes bafouées salies violées qui est convoqué dans ce cri d’effroi face à la barbarie sanguinaire ? Et c’est bien le viol en tant qu’arme politique, en tant que monnaie d’échange contre de la nourriture, « le rapport au monde le plus immédiat de l’enfer décrit » que fustige la romancière
« On n’a pas le pouvoir de changer les choses » confie la mère, résignée « parce qu’on est des femmes »
Un roman de la résistance où s’enchâssent plusieurs récits (mis en italique) ceux de John-John, Buki, Madara, Esaü, Rebeka, Daran comme autant de témoignages de l’humiliation de l’espoir et de la résilience ; un roman où des rites tels que l’exorcisme -confié d’ailleurs à une sorcière- côtoient des croyances ancestrales dans une perspective animiste -ne serait-ce que par l’interpénétration fusionnelle des règnes et des espèces…
Un roman aux couleurs pourpres de sang,Un roman de la lumière enténébréeUn roman à « la sombre splendeur » (cf 4ème de couverture)
-
"Un monstre et un chaos" de Hubert Haddad (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
En s’emparant du réel, d’un factuel vérifiable - le double asservissement des juifs du ghetto de Lodz aux nazis et au despote Rumkowski, qui avait conclu un pacte avec l’Ennemi esclavage contre survie -, Hubert Haddad cherche à le rendre palpable en l’incarnant dans le parcours/destin d’un enfant. Dualité et gémellité, réalisme cru et onirisme chagallien, traversent en un faisceau d’enchevêtrements une Déferlante, celle de l’Innommable ; alors que l’enfant à la blondeur botticellienne et à la souplesse féline, cet orphelin du chaos, à la chair déjà lacérée, à la mémoire déjà piétinée, semble porter en lui l’empreinte des vies échouées... (échos lointains avec l’enfant d’Opium Poppy ?)
Chant de la Douleur, de la Vie et de la Mort qui, dans cette fiction contre l’absurde, retentit de paroles et de musiques yiddish...
Du shtetl de Mirlek au ghetto de Lodz, l’auteur nous entraîne dans un véritable Cauchemar où le malheur collectif se conjugue avec celui d’un enfant. -Deux lignes/trajectoires : l’une inexorablement tendue vers la Mort, l’autre vers la (re)conquête de Soi se rencontrent se superposent bifurquent. Nous allons suivre le parcours d’Alter (ce prénom résonne d’emblée de multiples connotations) dans ses errances, sa quête de l’Autre qui est aussi quête de Soi, partager ses questionnements sur la monstruosité et le chaos. Le titre du roman -emprunté à Pascal et à Nietzsche- insiste précisément sur la sauvagerie de l’Homme dès lors qu’il a perdu toute humanité...Et la référence à Primo Levi -cité en exergue- n’en est que plus glaçante « c’est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau »
Au tout début l’emploi du pronom « nous » laisse supposer que le narrateur, Alter, forme avec son frère jumeau Ariel, un couple indissociable. Ce « nous » est relayé après la disparition du frère aimé, par un « il » (marque de la distanciation, de la dissociation) oul’enfant, le vagabond ; puis arrivé à Lodz Alter est contraint de changer d’identité : il sera « officiellement » Jan-Matheusza avant d’adopter le prénom du frère aimé dans son rôle de marionnettiste : il se produit sur la scène du théâtre Fantazyor (la devanture des songes) avec le violoniste nain Dumpf, et Bolmuche le fou de Shakespeare. Petit soldat de l’armée des anges, il a confectionné un pantin, son double, et les « deux » ainsi réunis forment un couple de pierrots lunaires. (l’expression est de Rebecca qui assiste aux répétitions). L’un est l’autre jusqu’à l’interprétation finale du chant des résistants de Varsovie…! De la fusion à la dislocation, (comme déporté hors de soi) de l’exclusion (dont le prénom serait la métonymie) à la dissolution... Et au recollement ? Ne serait-ce pas aussi la trajectoire du roman -en tant qu’interrogation sur la fiction et ses amers prolongements dans la réalité d’aujourd’hui ? N’est-ce pas celle vécue par une communauté ? Les brisures du vase laissent filtrer la lumière. Combien faudrait-il recoller de morceaux dissemblables comme les pièces d’un puzzle en trois ou quatre dimensions pour recouvrer la paix d’avant et presque le bonheur ?
Avec une certaine minutie l’auteur reconstitue ce que fut le ghetto Litzmannstadt ; des lieux, une ambiance, des odeurs que l’écriture fouille creuse en s’attachant aux détails -même les plus sordides- ! Un souffle épique palpite dans l’évocation de scènes où des humains ravalés au rang de Bêtes immondes forment une compacité de douleur et d’effarement, où la peur intensifie suspicion et défiance, où la maladie est l’antichambre de la mort, où le rendement dans les manufactures est synonyme d’esclavage, Foule rendue dolente par les privations... vouée à la déportation ! Le Monstre ? c’est bien évidemment l’inhumanité de la puissance qui a décidé l’extermination ; et dans le ghetto elle est incarnée par Hans Biebow. Mais c’est aussi la figure de la collaboration incarnée par Rumkowski - le doyen juif. Cet « histrion des bourreaux » croit galvaniser son auditoire en se prétendant émancipateur magnanime ; des arguments fallacieux ponctuent ses discours et particulièrement celui du 4 septembre 1942 -retranscrit en italique ; dans lequel il implore les familles de livrer leurs enfants de moins de 10 ans… Hans Biebow lui-même comprenait assez mal son énergie de petit caudillo et sa pusillanimité face aux dignitaires du Reich. Ce judéen négocie la survie des siens contre cent mille pièces de textile pliées et emballées, en chef d’industrie aussi véreux que pugnace dans un marché aux esclaves et aux chiens.
Mais dans cet Enfer, au cœur même du Désespoir, face aux « molochs de haine et d’acier » des îlots de résistance s’imposent -dans la clandestinité- et créent -dans le roman- un contrepoint dont la vibration célèbre le pouvoir de l’Art (plus que jamais les poètes nous sauvent) et bien vite se mue en une ode au yiddish (sans cette langue plus de peuple Itzkhok Peretz). Parmi les figures de résistants, citons le photographe Henrik Ross. Avec son "Leica 250 Reporter" suspendu à son cou il doit proposer des images convenues... (il travaille pour le bureau des identités et de la propagande). Mais à force de côtoyer l’Horreur -dont la pendaison de deux jeunes filles « bougies diaphanes étouffées dans le vent de la nuit » - il décide de filmer aussi « l’envers effarant du décor » : ce sera pour la Mémoire oublieuse, la preuve accablante et irréfutable de l’Ignominie ! Ou encore le Profesor Glusk qui après la mort de Gromeleck a pris à cœur la pérennité du journal clandestin ainsi que Shloyme Frenkel un chroniqueur.
Tout le texte d’Hubert Haddad retentit de refrains accompagnés de violons cymbales trompettes accordéons ou simplement chantés (chant de résistance éperdu, dit la 4ème de couverture). Au tout début on entend la berceuse chantonnée par Shaena, la mère des jumeaux, « shlof kindele shlof » Cette berceuse -du moins les premiers vers- viendra ponctuer à intervalles assez réguliers, des moments-clés du parcours (fût-il un songe) d’Alter/Ariel ; n’est-elle pas la formule magique qui guérit des fièvres et des sortilèges ? On chante en chœur Ot geyt ynkele (à la mémoire du poète Gebirig assassiné au ghetto de Cracovie) et c’est au final que retentira l’air du Partizanenlied…
De même on mime, on raconte des histoires d’évasion comme pour les colporter au-delà des barrières et transmuer la souffrance en mémoire Isaië Spiegel !
Écoutez-moi disait maître Azoï au théâtre des Quatre Sabots. Zet zhe kinderlekh vous autres près du fourneau ! Bientôt plus rien n’existera. Tant d’enfants et de jeunes partiront en fumée : ils ont refusé de plier l’échine. Mais je les vois se relever je vois leurs ombres vivantes. Il faut laisser la place à la petite flamme qui scintille et chanter et chanter la tête dans le fourneau.
On peut rendre le rêve plus grand que la nuit. (proverbe yiddish cité en explicit)
-
"La transparence du temps" de Leonardo Padura (éditions Métailié)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Elena Zayas.
Je veux être un écrivain cubain écrivant à Cuba sur Cuba. Telle était la réponse de Leonardo Padura aux questions de journalistes lors de son passage à Paris pour présenter son roman « La transparence du temps ». Des questions souvent insidieuses quand il est question de Cuba, de la Révolution castriste que la plupart des journalistes ont tendance à diaboliser... Les amis émigrent vers la Floride ou ailleurs ? Certes. Padura lui, en tant qu’écrivain, n’a pas voulu suivre l’exemple de Guillermo Cabrera Infante qui en exil n’a plus entendu la langue de La Havane et du coup a cessé d’écrire... (ce qu’incarnait le personnage d’Amadeo dans le film de Laurent Cantet Retour à Ithaque dont Leonardo Padura avait écrit le scénario) ; et en tant que citoyen il sera le « témoin intransigeant des évolutions sociopolitiques de son pays ». Tout comme son personnage fétiche Mario Conde... que le lecteur retrouve dans La transparence du temps – roman dont le titre sera décliné dans ses sens propre et figuré par le jeu de leitmotiv et de surimpressions.
Le roman s’ouvre sur une prise de conscience de la déchéance liée au vieillissement… C’est que Mario Conde va bientôt fêter ses soixante ans... Il se sent, il se sait « décati » (à l’instar du pays ? de son pays?). Certes il a son cercle de fidèles, ses amis, la femme aimée Tamara, sans oublier son chien Basura. Mais bientôt sonnera l’heure, tel un couperet : les 3 9 : 9 mois 9 jours 9 heures (en écho, tout à la fin, nous le verrons préparer le premier café de son 4ème âge le 9 octobre).
Nous allons suivre cet ancien policier hétérodoxe et fantasque, ce libraire désespéré, du 4 septembre au 12 décembre 2014. Ses interrogations sur le temps, sur ses angoisses existentielles, sur la fonction du roman, son regard très critique impitoyable et parfois empreint d’ironie sur les conditions d’existence des Cubains, épousent ses déambulations dans la capitale. Déambulations plus ou moins dictées par une intrigue policière : Bobby, un ancien ami de lycée, est venu le solliciter pour qu’il retrouve -moyennant finance- une statue de la vierge noire de Regla, volée par son amant… une crapule certes mais dont il est toujours amoureux !!!
En une vaste composition symphonique (et presque polyphonique) Padura fait alterner l’enquête - recherche du voleur, de la statue mystérieuse - avec des rebondissements, les risques d’une mort en héritage, un foisonnement de personnages, des déambulations dans des quartiers contrastés, moments de répit, rencontres rituelles avec les amis et/ou la femme aimée, et le voyage dans le temps de cette statue protectrice, à travers le récit des avatars d’un être historique Antoni Barral sans histoire qui dans l’Histoire vivait des existences romanesques fictives (avec une chronologie inversée de 1989 à 1291).
Les deux composantes du roman, loin de se juxtaposer, sont reliées par des thématiques communes et des raccords plus ou moins précis (le miracle par exemple : au chapitre 8 on apprend que Bobby a été sauvé de son cancer du sein grâce à la statue et au chapitre suivant, Jaume Pallard revient du monde des morts grâce à la « même » vierge) ; elles évoquent des découvertes similaires : à Saint Jean d’Acre Antoni Barral plébéien bourru né dans un village perdu catalan, est confronté à une ville opulente odorante commerçante et multiculturelle, à une vie effrénée et licencieuse où le vin et le sperme coulent comme la lave d’un volcan en éruption ; de même Conde découvre le monde de l’art et ses magouilles, le clivage qui oppose des milieux si opposés (dont un cauchemardesque de puanteur et de pauvreté extrêmes) alors qu’on avait tout mis en œuvre, à une certaine époque, pour l’abolir... Une vision similaire revient tel un leitmotive : celle d’un homme portant des sacs plastique en guise de chaussures, vision dont la dénotation s’inscrit dans la thématique de la « marche vers... ». Pieds endoloris incapables de conduire le père Joan, pieds inertes d’Antoni ; le grand-père de Bobby avait demandé que l’effigie de la vierge soit placée entre ses pieds pour le guider dans ses derniers pas ; pieds en feu de Conde, etc. En connotation elle s’inscrit dans la « transparence du temps » -cette « patine déformante mais translucide comme l’eau des ruisseaux de montagne à travers laquelle il se voyait prenant et reprenant ses chemins avec la persistance de ce qui est éternel et inévitable comme une créature errante dans et hors du temps. Mais c’est le 8 octobre 2014 (soit la veille de son anniversaire) que Conde prend conscience - à travers un dédoublement à la fois salvateur et angoissant - de l’étonnante confusion entre vie et écriture fragments ataviques de diverses vies condamnées à être attirées par l’Histoire comme si tu voyais l’Histoire et le temps à travers le voile transparent d’une larme ; est-ce cela écrire : se transmuer en un autre ? Renoncer à soi au profit de la création…
Dans « La transparence du temps », outre cet art du rendu (paysages situations burlesques ou tragiques) de l’alliance sublime et trivial et de l’auto-dérision, la coexistence d’une aventure moyenâgeuse et d’une enquête contemporaine, non seulement témoigne de l’habileté de son auteur, mais prouverait -une fois de plus- que la littérature est ce lieu unique où le fugace a la permanence de l’éternel...
-
"Pas dupe" d'Yves Ravey (Editions de minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Si le titre « pas dupe » par son laconisme à valeur programmatique renvoie en écho inversé à « pris au piège », il peut fonctionner comme une « preuve » dans le cadre d’une enquête policière, - le thème de ce roman paru en mars 2019... D’emblée le romancier dit ainsi se jouer des codes du roman policier ou du moins en faire une parodie ; d’emblée il inviterait son lecteur à ne pas se laisser prendre au piège… ?? Lequel ? Celui tendu par les personnages entre eux ? Le narrateur Salvatore ? Un loser -comme souvent les narrateurs chez Ravey- qui avec sa femme Tippi, avec son beau-père, tout comme avec l’inspecteur, met un point d’honneur à déjouer certaines roueries ? L’inspecteur Costa qui tel Colombo, revient sans cesse à la charge en jouant le candide ? La voisine Gladys Lamarr dont le témoignage et le regard perspicace de « voyeur » font avancer « l’enquête » ? Le beau-père Bruce, qui « lit dans les pensées de son gendre » ? Celui tendu par le lacis de ces faux dupes, eux-mêmes manipulés par un marionnettiste qui tire tous les fils ?
Quand bien même ! Sceptique, curieux, suspicieux, compatissant ou amusé, le lecteur -sans être vraiment dupe- est entraîné dans une aventure, séduit par une écriture très clinique (au scalpel). Pas dupe : un roman dont le sens est précisément celui de l’enquête »(de l’aveu même de l’auteur)
Un constat. L’auteur a déplacé son « intrigue » des régions de l’est de la France, en Californie (tout au plus Vicky, la tante de son roman précédent rentrait de la Foire du design de Miami). Le prénom de la défunte Tippi est celui de l’héroïne des Oiseaux (Hitchcock) alors que le patronyme Kowalzki a les consonances des pays de l’Est (celles qu’affectionnait le romancier). Nous voici à Santa Clarita. La société du beau-père Bruce Cazale est une « entreprise de démolition » (on ne peut que sourire en songeant aux éventuelles analogies avec le couple d’une part, et avec l’entreprise romanesque d’autre part). Un night-club le Saïgon, le bar de Donovan. Une cimenterie désaffectée. L’agence Pacific. Le poste de police Des pavillons ultra bourgeois. Le canyon Un ravin. Lieux où se jouent la tragédie de la Mort, la comédie des apparences. Mais c’est surtout le personnage de Costa double de Colombo, qui des séries télévisées entre en écriture ; à ceci près que dans les épisodes, le spectateur connaît dès le début l’assassin et qu’il suivra amusé et complice voire désarçonné la démarche de l’inspecteur, pour le démasquer. Ici on est confronté à une énigme : la mort de Tippi au volant de sa berline, accident ou homicide ? Et avec sa manie de fureter partout Costa ne négligera aucun détail... jusqu’au harcèlement !
Comme souvent dans les romans d’Yves Ravey, l’incipit a une force suggestive tout en livrant des éléments informatifs essentiels au récit.« j’ai revu Kowalzki au bord du précipice ». L'auteur donne la parole à un narrateur, ici Salvatore Meyer qui s’exprime(ra) à la première personne « je » ; l’emploi du passé composé prouve que les faits rapportés ont déjà eu lieu ou sont dans l’instantanéité de l’écriture (qui rappelle celle du Meursault del’Étranger?) ; le préfixe itératif du verbe revoir est plein de sous-entendus -ce que confirme la suite du paragraphe d’ouverture « je connaissais bien Kowalzki... depuis pas mal de temps amant de Tippi, ma femme morte dans l’accident. L’air hagard de l’amant, l’impassibilité apparente du narrateur (en harmonie avec celle du personnage ?) la neutralité de l’écriture, la position du regardeur « au bord du précipice » tout cela fonctionne comme autant d’indices qui pourraient se parer de connotations (mais on sait l’auteur hostile à toute tentative psychologisante)
Le découpage en chapitres correspond à un « élément » nouveau, une question, une incidente, une forme de « relance » que l’inspecteur peut présenter comme une « routine » une « simple formalité » ou « indispensable à l’enquête ». .Annoncée à la fin d’un chapitre la relance fera l’objet du chapitre suivant (inutile de les répertorier pour ne pas entacher le plaisir de la lecture/découverte). Simultanément s’opère un autre dévoilement : celui de la personnalité » du narrateur. Salvatore Meyer est d’abord décontenancé par les questions insolites de Costa. Constamment humilié par les siens, (n’est-il pas un « bon à rien »?) il est capable de se rebiffer. Alors que les dialogues sont restitués au style indirect (avec cette abondance de points de suspension qui marquent une pause, un silence) les pensées intimes du personnage le sont au style indirect libre, le lecteur étant son seul complice !
L’enquête loin de piétiner (c’est un grief récurrent de Salvatore Meyer) voit momentanément sa trajectoire se briser (à l’instar de la bouteille lancée par Bruce dans le vide… ??) par l’intrusion de mini séquences à connotation érotique. Gladys de simple voisine se métamorphose par la « magie des sous-entendus » en une mystérieuse séductrice ; (le style s’en trouve d’ailleurs contaminé) et ce, juste avant la « révélation » où dire et voir coïncident dans la résolution de l’énigme
Un roman où la mise en scène -avec ses cadrages, les déplacements des personnages et le hors champ- va reposer sur de simples objets. La boîte à biscuits ne renvoie-t-elle pas au coffre-fort de la tante Vicky dans « trois jours chez ma tante » ? A la valise métallique de List dans l’Epave ? À la boîte à gants (montre) et la boîte à sucre (argent) dans Cutter ?
Outre le pactole, on y enferme les non-dits en même temps que la part sombre de soi-même…
-
"Manifesto" de Léonor de Récondo (éditions Sabine Wespieser)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Léonor de Récondo et sa mère Cécile sont au chevet de Félix (le père et l’époux) à l’hôpital de la Salpêtrière ; elles vont vivre avec lui ses derniers instants dans cette chambre 508. De ce dernier acte de la vie, d’Unevie,(avec son unité de lieu et de temps, la nuit du 24 au 25 mars 2015) la romancière va écrire le « manifeste » pour mourir libre, il faut vivre libre... En imaginant quelles furent les dernières pensées de son père, en les faisant siennes, elle convoque le passé de cet exilé espagnol, de ce dessinateur sculpteur, de ce père aimant, et transforme sa vie en destin…
Ce qui frappe d’emblée à la lecture de ce récit autobiographique c’est sa composition originale et subtile Chacun des 28 chapitres comprend deux mouvements, deux narrations, deux types de discours. Un dialogue imaginaire et rêvé entre Félix de Récondo et Ernesto Hemingway ; assis sur un banc ils vont « se raconter » emplir le ciel des détails de leurs souvenirs (et le chapitre 1 joue le rôle de mise en abyme dans la mesure où il contient tous les thèmes de la conversation à venir) ; Félix conscient de sa mort prochaine, Ernesto fantôme renaissant des limbes. L’autre « récit » est une voix intérieure celle de Léonor : elle s’adresse à son père mourant, l’interpelle et simultanément dit sa propre douleur. Dans le premier mouvement, le temps est comme dilaté et correspond à des blocs harmoniques ; dans le second le temps chronométré (mais vécu sur le mode d’une attente presque interminable) est celui du dépouillement dans une atmosphère de rituel. Et c’est l’ensemble ainsi éployé qu’elle dédie sous forme de tombeau (dans les deux sens du terme, littéraire et musical) au père disparu. Une polyphonie (je voudrais retenir vos voix à tous en faire une polyphonie) où vibrent les voix « chères qui se sont tues » et celle d’une narratrice aimante et aimée. Réminiscences et intermittences
Deux narrations en montage parallèle, donc, avec leur spécificité, mais où les raccords et les échos les font se croiser et non se juxtaposer en morceaux éclatés (comme le découpage en instantanés et l’impression de rythme brisé le laisseraient supposer). Ce qui va bien au-delà du clivage « vie » et « mort » (même si dès la fin du chapitre 1 éclate telle une évidence solaire le primat de la Vie (Ernesto tu es en vie ; Toi aussi Félix).
Il y a certes des thèmes récurrents : l’arbre, le corps qui impriment au dialogue fictif la brillante densité d’éclats de vie ; et la mort omniprésente qui électrise de sa morsure fulgurante les deux narrations « on meurt et on agrandit l’âme de ceux qui nous aiment »
Mais c'est le violon qui, motif musical par excellence, joue le rôle de leitmotiv. Ernesto dès le début s’impatiente « et le violon quand est-ce que tu vas me le montrer Félix » « pas encore le violon c’est pour la fin, la belle fin ». Nous assisterons à la confection de cet instrument, une confection lente et patiente; qui aura transfiguré le sculpteur Félix en luthier. La façon doit disparaître, ne doit rester que le miel vibrant du vernis qui s’assombrit dans la veine du bois Et c’est précisément cette métamorphose du geste créateur qui entrelace les deux narrations, impulsant en filigrane un questionnement sur l’Art en général, sur la Création. C’est sur le violon que se clôt le récit ; la narratrice imagine l’archet entre les mains du très vieux berger... Or Félix ne disait-il pas que « de l’étreinte (violon/corps de Léonor) naissait un son qui venait mettre en résonance une onde plus lointaine plus archaïque, cosmique [...]... qui traverse les temps » ?
Au leitmotiv du violon s’ajoute tout un jeu d’échos intérieurs, échos feutrés qui disent la perte, l’attente. Félix vivant, auprès du corps mort de sa fille en 1990, puis de son fils ; Léonor vivante, au chevet du père aimé qui se meurt. Félix prend la petite main moite de sa fille fiévreuse, Léonor prend la main de son père et la caresse pour qu’il « sente sa présence » . Felix reste toute une nuit auprès de sa fille, il voulait voir l’hésitation de son réveil le sourire qui naît à l’aube du jour nouveau. Léonor reste toute une nuit guettantle moindre souffle dela vie avant..l’issue fatale...
Échos variations aussi : au rêve de Léonor (prologue) répondent ceux d’Ernesto et de Félix (ici cauchemar prémonitoire). Aux « je » de Félix et d’Ernesto, répond le « je » de la narratrice/Léonor. Le « très vieux » qui engueulait les « petits salopards » tentant de taillader l’arbre de Gernika l’âme de la ville et qui les terrifiait par des histoires de « revenants », nous allons le retrouver au final ; lui qui est mort dans les décombres de sa maison bombardée joue le rôle du coryphée dans les chœurs de la tragédie grecque, il entraîne tous les fantômes que Léonor de Récondo avait convoqués… vers...
Le « je » de la narratrice s’est effacé
C’est un chant auquel répond en écho la montagne
On comprend mieux le sens de l’exergue emprunté à Dante (là se forma une voix qui sortit ensuite par son bec en forme de paroles ; celles qu’attendait le cœur où je les écris »
Récit pudique et délicat, tout en émotion contenue malgré la Douleur éprouvée, Manifesto est un hommage au père, un « somptueux éloge de l’amour, de la joie partagée et de la force créatrice comme ultime refuge à la violence du monde (cf 4ème de couverture)
-
"Ce que savait la nuit" d'Arnaldur Indridason (éditions Métailié)
traduit de l'islandais par Eric Boury
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Exit Erlendur -le commissaire si familier aux lecteurs d’Indridason ! Voici Konrad un flic à la retraite. Qui est-il ? Pourquoi malgré les réticences affichées reprend-il une enquête (cold case) vieille de 30 ans ? Ou du moins pourquoi s’investit-il dans celle concernant Villi, mort il y a 7 ans ? Est-ce seulement pour satisfaire à la requête de la sœur de la victime ou cette mort serait-elle liée à la première -celle de Sigurvin disparu il y a trois décennies ?
C’est sur la découverte du cadavre sous le glacier de Langjökull que s’ouvre d’ailleurs le roman…
Un roman où deux lignes de force en parallèle se dessinent, tissent des liens et se croisent. Les fragments de la vie de Konrad sont livrés au lecteur d’abord avec parcimonie éveillant indubitablement sa curiosité puis des pans entiers sont restitués sous forme de flash-back (gamin souffre-douleur de Poli à cause de son infirmité ; relation au père - un homme peu recommandable ; relation avec sa femme Erna décédée il y a peu de temps). À un moment du récit Konrad cherche à rassembler les fragments de son existence pour en reconstituer le puzzle. Or n’est-ce pas cette démarche qui préside à son investigation, comme à toute enquête d’ailleurs ? Car il faut collecter les informations, les sérier, les contextualiser et par regroupement et recoupement, établir des hypothèses, adopter le point de vue de tous les protagonistes. Vont se succéder à un rythme assez rapide (et beaucoup de chapitres débutent par cet indice temporel « le lendemain ») ses rencontres/entretiens avec tous ceux impliqués de près ou de loin (la sœur de Villi Herdis, celle qui lance l’alerte, les témoins de la scène d’altercation au bar ; les proches de Villi etc.) Un indice majeur revient en leitmotiv : la jeep. Dans cette enquête complexe, Konrad doit « emboîter les pièces éparses du puzzle ». Elisabet reproche à son frère de « penser comme un flic », « tu veux croire aux coïncidences, au hasard qu’il y a un lien ». Oui il y a forcément un lien !
Ainsi, de même que se dévide l’écheveau de sa propre vie (tout en sachant que Certains morceaux s’adaptent mal à l’ensemble, d’autres parmi les plus importants manquent à l’appel) de même se déploie en une toile arachnéenne la « mission » qu’il s’est imposée. Vers la fin du roman se rappelant le fiasco de l’affaire Sigurvin (il fut mis à pied) il prend conscience qu’elle avait marqué sa vie, façonné sa personnalité.
La construction du roman obéit à cette architecture assez savante à laquelle Indridason nous a habitués. Le mouvement entre l’enquête et les allers et retours entre passé et présent assure un tempo ainsi que l’alternance narration/dialogues, et l’immersion par petites touches dans le passé islandais reliant la petite histoire fictionnelle à la grande Histoire. Mais certains raccords font voler en éclats la linéarité du récit : après la découverte du corps de Sigurvin par des touristes (chapitre 1) Indridason nous plonge sans transition dans la conscience d’un individu entre vie et trépas - il vient d’être renversé par une voiture (chapitre 2) ; or les deux événements ne sont pas concomitants d’un point de vue chronologique, mais le lecteur se substituant à l’enquêteur va les « relier »... Cette victime -sujet de l’enquête et dont on apprendra très vite l’identité- nous la retrouverons au tout dernier chapitre (60) bercée par la vieille dame qui tente de la consoler… sorte de thrène moderne dans le noir qui a tout englouti. L’enchâssement de récits dans le récit illustre la complexité du « réseau » à démêler et permet d’étayer des « soupçons ». Souvent des indications d’ordre climatique ou météorologique ponctuent la narration, servent d’ouverture à certains chapitres ; outre leur fonction informative elles entrent en immersion avec l’intime de personnages. L’exemple le plus poétique est l’éclipse de Lune : à la demande expresse de sa femme « mourante », Konrad l’accompagne dans la contemplation d’un ciel « scintillement venu du passé ; course immémoriale des planètes ; la lune boucle de la nuit, antique amie des amants….
Des portraits traités tels des eaux fortes : Indridason a sans conteste l’art de déceler chez tous ses personnages une spécificité vestimentaire ou tout simplement physique ; son regard est amusé, parfois moqueur (Olga aux archives de la police « ressemblait un peu à un gros classeur », la vieille Vigga à l’accoutrement et à la grimace de « sorcière » …)
Réchauffement climatique -il a favorisé la découverte du cadavre Sirguvin...- misère sociale et alcoolisme, corruption ; on retrouve dans ce roman, des thèmes chers à l’auteur.
On sait aussi sa passion pour ce qu’il appelle « squelettes vivants ». Mes romans traitent de disparitions, mais ils ne traitent pas principalement de la personne qui a disparu, plus de ceux qui restent après la disparition, dans un état d'abandon. Je m'intéresse à ceux qui sont confrontés à la perte. Ce sont ces gens-là que j'appelle les squelettes vivants.
Konrad n’est-il pas de ceux-là ??
-
"Frères sorcières Entrevoûtes" d'Antoine Volodine (éditions Seuil)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Hadeff Kakaïn sortant de la matrice -goulet de la mauvaise moinesse- entre dans un monde qui lui est vaguement familier ; de même un lecteur fidèle de Volodine (et de ses hétéronymes) entrera avec Frères sorcières dans un monde qui ne lui est pas complètement étranger : celui du post-exotisme, celui où les repères sont flous ou abolis (on côtoie des errants ni nés ni décédés ; une indistinction qui vaut aussi pour le rêve et la réalité, la vérité et le mensonge, le passé le présent et le futur), celui de l’espace noir charbonneux et/ou des espaces bardiques, celui des paysages d’après la catastrophe, avec leurs toponymes aux consonances étranges parce qu’étrangères ; un paysage mental où « erre » la conscience d’un être transitoire ; un monde qui advient par le souffle d’une écriture à la fois organique et orphéique !
MAIS…..
Entrevoûtes ! Ce vocable hybride (c’était le sous-titre de Nos animaux préférés) mêle le substantif entrevous espace entre deux solives de plafond ou les poutres d'un plancher, et le verbe entrevoûter termes d’architecture certes mais comme se plaît à le rappeler l’auteur avec des règles plus fondamentalement musicales que géométriques, c’est bien la part sonore de la langue qui est -entre autres- convoquée dans Frères sorcières. Et la première impression -en entendant les trois voix apparemment différentes- serait celle d’un pluralisme tonal. Eliane Schubert (la première voix) parle comme si elle faisait une déposition, -elle évoque le parcours de sa troupe de théâtre, le lien avec le public, le programme, les turpitudes des bandits, les morts- et sa parole est souvent interrompue par un « inquisiteur » (?) qui la somme de se contenter du factuel ! Parole relayée en II par 343 vociférations réparties en 49 fragments (on connaît l’importance du chiffre 7 et de ses multiples pour l’auteur), des recommandations, des invitations plus que des objurgations, -malgré l’emploi de l’impératif- destinées à toutes les petites sœurs du malheur ; vociférations qui ne sont pas sans rappeler les slogans de Maria Soudaïeva. Puis en III (dura nox, sed nox) nous entendons un long monologue d’une seule phrase, la voix d’un vieux chamane (frère de Solovïei de Terminus radieux?) dont nous suivons les errances dans l’espace noir, (que scande la récurrence de la préposition « puis ») et les différentes métamorphoses (où genre et sexe sont abolis).
Mais dans tous les cas il s’agit du Corps de la parole et/ou de la Voix de la chair. Au début le Verbe et le Verbe s’est fait Chair si l’on voulait parodier le fameux « in principio erat verbum ». Hormis le fait qu’on est dans une sorte de transe chamanique ; que le « rapport à la voix » induit la théâtralité ; l’envie d’un théâtre libérateur ; qu’on a donc dépassé le cadre narratif propre au roman. (Le titre de la première entrevoûte est éloquent « faire théâtre ou mourir »).
Les trois entrevoûtes loin d’être trois unités différenciées, se répondent par tout un jeu d’échos intérieurs en s’imbriquant les unes dans les autres. Eliane Schubert, seule survivante de la Compagnie de la Grande-nichée, a reçu en héritage de sa grand-mère et de sa mère la puissance des salves de slogans ces vociférations étranges. Elle connaît par cœur l’intégralité du texte, et pourrait encore l’interpréter sans mal. (Eliane double de Maria Soudaïeva ? sœur de Maleeya Bayarlag des "Songes de Mevlido" ?). La première « entrevoûte » se clôt sur une recommandation qui sera précisément la dernière de cantopéra « retourne à la Grande-nichée » ; ainsi les 343 vociférations de la deuxième entrevoûte sont le texte de la pièce étrange qui habite cette comédienne. Quand Eliane Schubert constate qu’elle est sur une scène de théâtre et qu’une petite tache minuscule pétrifiée en pleine flaque lunaire joue un rôle dans son histoire, ce sont précisément les recommandations des fragments 9 10 11 à la petite sœur de l’épeire et 16 17 (l’aragne) et qui annoncent la métamorphose d’Hadeff (en III) (après 8 mois d’immobilité, il a « l’apparence d’arachnide » cette petitesse l’aidera à sortir du tunnel vers la/une Re-naissance). La construction circulaire en III (la fin nous ramène au point de départ- après la reprise in extenso des quatre premières pages du début)- a la puissance de l’incantation -tout comme les vociférations (mises en relief par l’emploi de majuscules) avec l’énoncé lapidaire des injonctions et la récurrence de certaines images.
Circularité et errance sans fin. À l’errance d’Eliane et de sa troupe de théâtre vers le nord-est répond celle d’Hadefff dans l’espace noir ; à toutes les « expériences » -fussent-elles les plus cruelles et les plus douloureuses- de l’une répondent celles du second alors que les vociférations sont comme la clef de voûte d’un édifice sonore. Encore que « la clef voûte » est loin d’être statique : en perpétuel mouvement, elle préside plutôt à l’élaboration d’un monde envoûté et envoûtant Incantation et envoûtement. Maria Crow puis Yee Mieticheva sont comme ensorcelées en écoutant (et en les faisant leurs) les vociférations d’Eliane Schubert ; les petites sœurs destinataires des vociférations (en II) sont aussi les frères sorcières (et pourquoi pas le public et/ou le lecteur/frère) Hadeff /Amandine/Bella Ciao/ Babour Marsyas/ Moô-Moô/Jean Goliathan/ Jean l’Insolente/ Jeanne le Goudronneux/ La traditionnelle fonction phatique du langage (moi Amandine, par exemple) se transmue en parole magique où le mot proféré fait advenir la chose nommée, où la vocifération déclamée crée le réel souhaité espéré ou honni Magie de l’écriture, magie du Chaos !
Ce roman, le 43ème d’un « édifice » qui en comportera 49 (ce sont les propos de l’auteur invité sur le plateau de La Grande Librairie le 16 janvier 2019) frappe par son hallucinante puissance hypnotique. Transporté, le lecteur (qui est aussi spectateur) n’en oubliera pas moins la force de dérision -voire auto-dérision-, le goût pour les pastiches, les jeux de mots, l’intertextualité, et une réflexion en creux à la fois politique et existentielle Frères sorcières, un texte incontournable !
.13. 76 EN CAS DE MALHEUR, OUVRE TA GOURDE LACRYMALE ET ATTENDS LA SUITE !
.16. 99 QUAND LA FLAMME DÉSARTICULE LE LANGAGE EN TOI, ENFLAMME-LA !
.35. 244 PETITE SOEUR, AVANCE SANS FRÉMIR, AVANCE, FRAPPE !
.44. 317 APRÈS LA FIN DE TOUT VOYAGE, REPRENDS LA ROUTE
.49. 337 HABILLE-TOI AVEC DE LA CHAIR !
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact






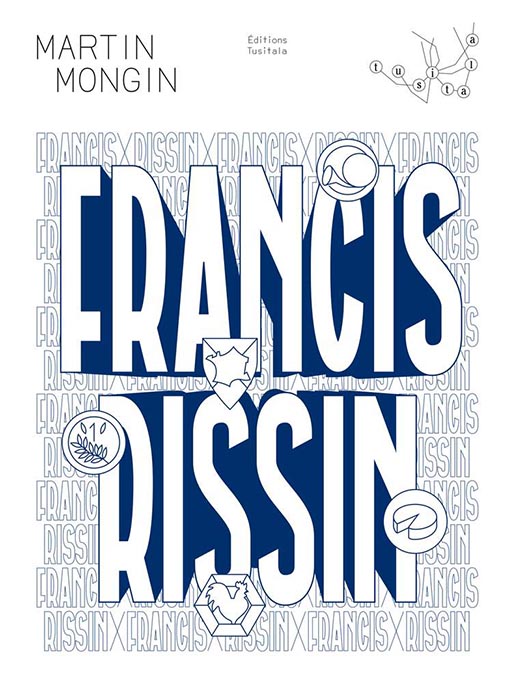

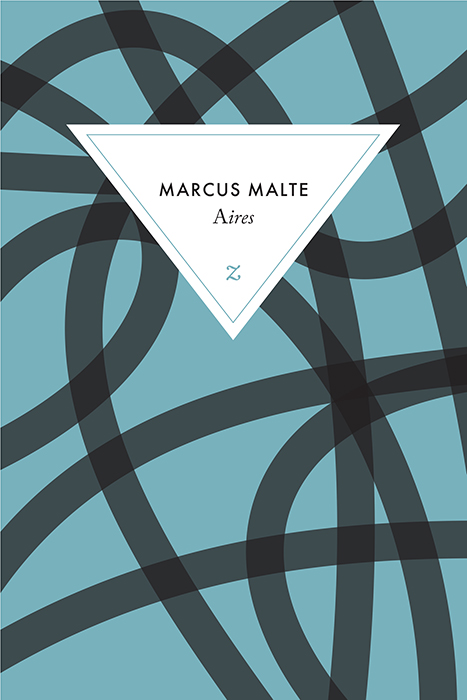

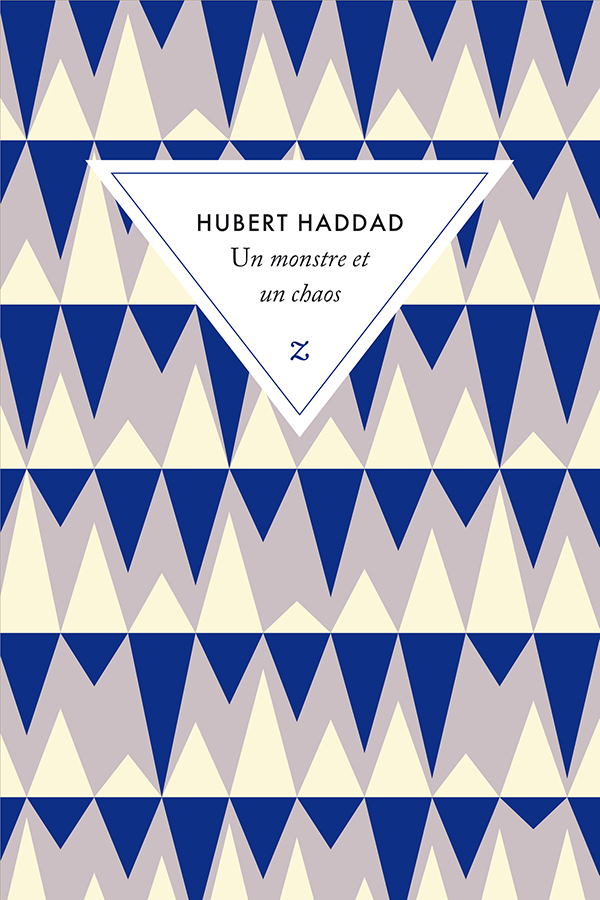

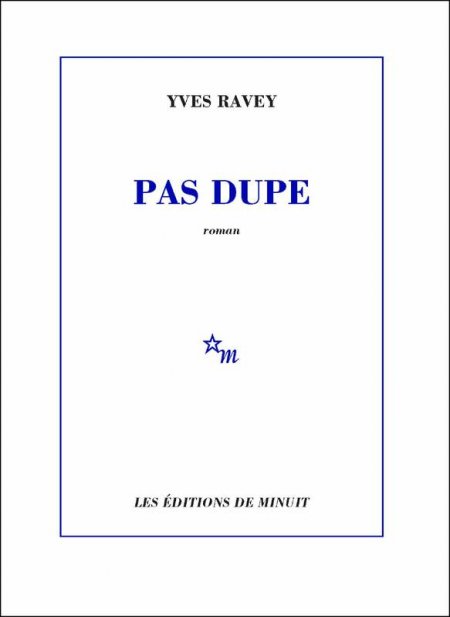

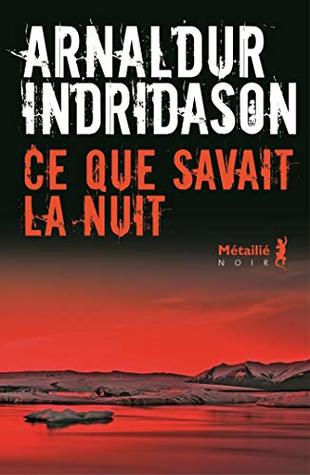

![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)